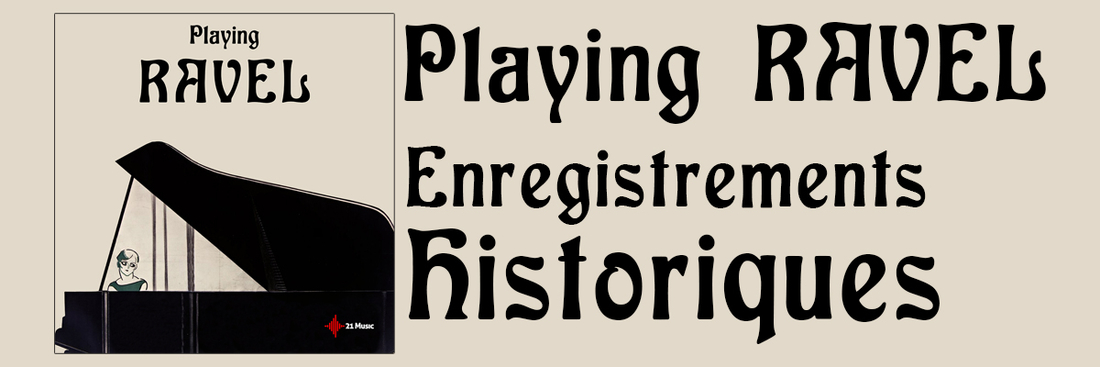Au Covent Garden, une contestable Theodora de Handel
George Frideric Handel (1685-1759) : Theodora, oratorio en trois actes. Julia Bullock (Theodora), Joyce DiDonato (Irene), Jakub Józef Orliński (Didymus), Ed Lyon (Septimius), Gyula Orendt (Valens), Thando Mjandana (Marcus) ; Chœurs et Orchestre du Royal Opera House, direction Harry Bicket. 2022. Pas de notice ; bref synopsis en anglais. Sous-titres en anglais, en français, en allemand, en japonais et en coréen. 189’00’’. Un DVD Opus Arte OA1368D. Aussi disponible en Blu Ray.
C’est à Londres, le 16 mars 1750, qu’est créé, avec un succès plutôt mitigé, l’oratorio Theodora que Handel a composé moins d’un an auparavant, du 26 juin au 31 juillet. Le livret s’inspire de l’ouvrage de l’homme de science et philosophe Robert Boyle (1627-1691) The Martyrdom of Theodora and of Didymus, qui date de 1687 ; il est signé par Thomas Morell (1703-1784), déjà auteur de textes pour le compositeur, notamment Judas Maccabæus et Joshua. L’action se situe au début du IVe siècle de notre ère, en 304, sous le règne de l’empereur Dioclétien, au cours duquel une sanglante persécution des chrétiens a lieu. A Antioche, le gouverneur romain de la ville, Valens, ordonne des festivités en l’honneur du César du temps ; ceux qui refuseront un sacrifice à Jupiter seront châtiés. Le jeune Didymus, un officier de sa garde, demande la clémence pour ceux qui pratiquent un autre culte, ce que refuse le gouverneur. Didymus demande de la souplesse à Septimius, qui est chargé d’exécuter les ordres, mais n’est pas insensible à l’appel. Une chrétienne, Theodora, dont Didymus est amoureux, refuse de se soumette, approuvée par ses amis qui partagent sa foi. Arrêtée, elle est condamnée à être livrée aux soldats. Didymus jure de la libérer. Il arrive à s’introduire dans la prison et fait échapper la jeune femme en échangeant ses vêtements avec elle. Didymus est condamné à mort. Theodora se livre dans l’espoir de le sauver. Inflexible et cruel, le gouverneur les fait exécuter.
Comme l’a écrit avec pertinence Jean Gallois en 1980 (Seuil, Solfèges), l’ouvrage de Morell, ni pédant ni sermonneur, se présente à nos yeux comme un des meilleurs dont il ait pu disposer, offrant au musicien, au-delà de personnages devenus symboles, une construction extrêmement diversifiée dans le développement des scènes. Plusieurs DVD ont été déjà disponibles : celui de Glyndebourne en 1996, dans une mise en scène de Peter Sellars, sous la direction de William Christie, avec Dawn Upshaw et David Daniels (NVC Arts) ; un autre au Festival de Salzbourg en 2009, mené par Ivor Bolton, avec une mise en scène de Christoph Loy et les voix de Christine Schäfer et Bejun Mehta (C Major, 2011) ; et un troisième en 2015, à Paris, à nouveau par William Christie, avec Katherine Watson et Philippe Jaroussky (Erato, 2017), mise en scène de Stephen Langridge. Les trois versions ont d’éminentes qualités, notre préférence allant à celle de Salzbourg pour sa puissance émotionnelle ; la transposition de l’action à l’époque moderne ne constituait en rien une difficulté. Aujourd’hui, c’est Opus Arte qui propose le spectacle filmé les 7 et 12 février 2022 au Royal Opera House de Covent Garden, sur les lieux mêmes de la création. Et là, c’est une autre paire de manches !
L’Anglaise Katie Mitchell (°1964), qui a déjà signé des mises en scène d’opéras, notamment de Donizetti, Luigi Nono ou George Benjamin, a opté pour la radicalisation du propos : Theodora et son amie Irene sont des chrétiennes extrémistes de notre époque qui travaillent au siège de l’ambassade romaine et préparent un attentat pour la détruire. Le décor va utiliser cinq lieux qui apparaissent ou disparaissent, selon la nécessité, à l’aide de panneaux coulissants : une immense cuisine où les femmes travaillent avec d’autres chrétiens, une salle de réunion attenante, un lupanar juste à côté, jouxté à une chambre dans laquelle Theodora va être séquestrée et violentée, et, en annexe à la cuisine, une chambre frigorifique, dans laquelle Theodora et Didymus vont trouver la mort, au milieu de grands quartiers de viande suspendus. Le souci, c’est que l’option terroriste et violente des chrétiens est en contradiction avec l’essence même du livret, les porteurs de la foi nouvelle n’y ayant à la bouche que des mots d’amour, de vertu, de tolérance, de compassion, de sacrifice, de louanges pour le Seigneur et d’ouverture vers le ciel. On se retrouve donc dans un contexte détourné qui a déjà bien fait couler l’encre de la critique, entre approbation et quasi-rejet.
La « fragile » Theodora apparaît dans ce contexte comme une victime, mais aussi comme une aventurière prête à tuer. Et elle est loin d’être la seule ! La fin, tout à fait inattendue, subit des modifications que nous laissons au spectateur le soin de découvrir, et jette sur son personnage un éclairage interpellant. Si l’on se penche sur l’évolution de l’histoire qui est racontée ici, on se trouve confronté à des scènes de préparation minutieuse d’explosifs, puis de violences -notamment la perte de virginité de l’héroïne (dont on nous épargne quand même les détails)-, et de luxure (on a vu pire dans le domaine). Mais on sombre parfois dans le burlesque, pour ne pas dire le ridicule, en particulier dans l’Acte II. Didymus a réussi à s’introduire dans le bordel où Theodora est détenue. Pour la faire échapper, ce dont elle se défend avant de céder à son insistance, il lui propose d’échanger leurs vêtements respectifs. Contempler Jakub Józef Orliński se mouler dans une robe aguichante en lamé or, enfiler des hauts talons, avant, cerise sur le gâteau, de se coiffer d’une perruque ébouriffante, puis le voir s’adonner vaille que vaille aux acrobaties de la pole dance à côté d’une prostituée, est un moment que l’on peut regarder avec consternation. Mais il vaut mieux en rire ! On ne saisit pas non plus la nécessité de scènes jouées au ralenti, suggestives de violences, même si elles sont bien mises en espace. Pour en diminuer l’impact, ou pour l’accentuer ?
On a déjà glosé abondamment sur cette présentation londonienne qui mélange le fanatisme, la cruauté, la domination masculine et les excès subis par les femmes, tout en faisant passer au second plan un message qui évoque avant tout la capacité de dépasser l’amour humain et souligne l’abnégation totale des personnages par la voie du martyre. Du coup, le sacrifice ultime de Theodora et de Didymus perd la plus grande partie de sa puissance d’exemplarité et de profonde aventure spirituelle. Les avis seront sans doute partagés, répétons-le, et l’approche radicale sera appréciée ou non selon la perception de chacun. En ce qui nous concerne, nous l’estimons dérangeante. Ce qui est certain, c’est que l’unanimité se fera sur la musique subtilement flamboyante de Handel, entre ombre et lumière, sur les airs savamment distillés et inspirés, et sur les interventions magistrales des chœurs.
La distribution vocale sera un baume bienvenu pour ceux qui prendront leurs distances avec la mise en scène. La soprano américaine Julia Bullock, originaire du Missouri, est une Theodora émouvante à la voix virtuose et à la riche expressivité (douloureux With darkness deep, lors de sa captivité). Jakub Józef Orliński, physique juvénile et avantageux, timbre bien posé et chaleureux, est un intense Didymus (suave Sweet rose and lily). Leurs duos sont équilibrés, même si, en raison du final escamoté, on passe un peu à côté de l’ardent échange Stream of pleasure du martyre final. Si le baryton d’origine roumaine et hongroise Gyula Orendt est un crédible Valens, cruel et inflexible à souhait, le rôle plus ambigu de Septimius, exécuteur des basses œuvres, qui manie habilement l’art de la duplicité, est l’apanage réussi du ténor britannique Ed Lyon. Il y est convaincant, comme l’est le jeune ténor sud-africain Thando Mjandana dans le personnage épisodique de Marcus. Quant à Joyce DiDonato, aussi élégante en cuisinière qu’en dame d’entretien, son incarnation d’Irene est d’une perfection exemplaire, non seulement quant à sa qualité de présence, à la fois pondérée et engagée, mais aussi de par son éblouissante beauté vocale. A l’Acte I, As with rosy steps the morn, ou l’air Defend her, Heav’n, let angels spread du II, sont admirables. Les chœurs sont superlatifs de bout en bout. La direction de l’Anglais Harry Bicket révèle toutes les facettes d’une partition que l’on écoute avec délices, l’Orchestre du Royal Opera House étant à la hauteur de cette partition de haut niveau.
On aura compris que ce spectacle crée la perplexité en raison des options choisies et par ce que nous considérons comme un détournement de l’essence même de l’œuvre. Une chose nous tarabuste quand même. Le public se révèle très enthousiaste à la fin de la soirée. La question se pose : vers qui vont les ovations ? Nous voulons croire qu’elles s’adressent aux seules performances des voix. Mais qui peut en être sûr ?
Note globale : 6,5
Jean Lacroix