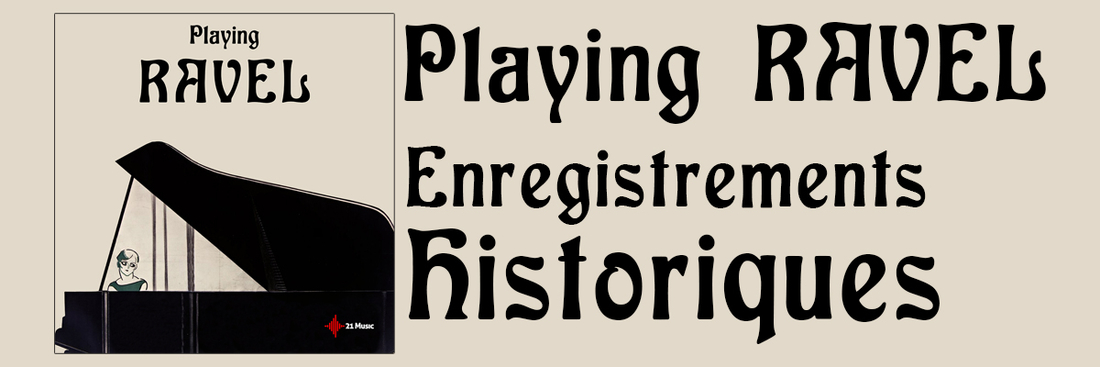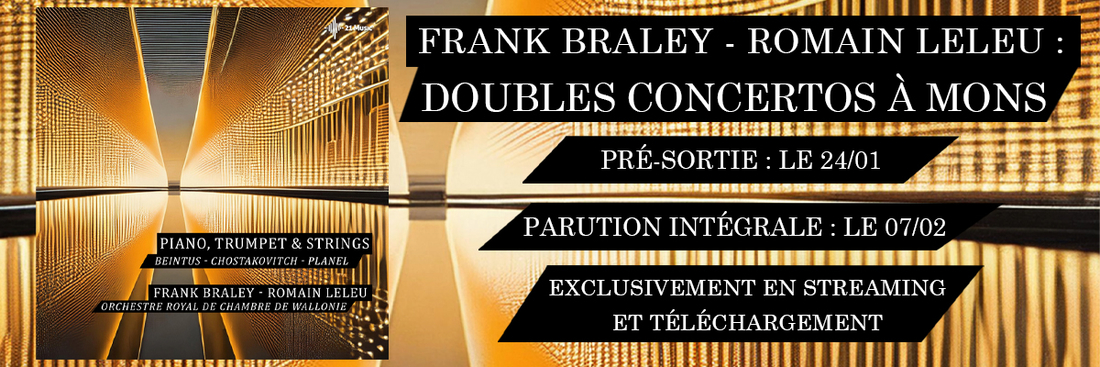‘Callas’, une pièce dansée : Infelice Maria !!!
Cara Maria, à quarante ans de ta disparition, à toi qui as changé radicalement le monde de l’opéra, fallait-il te rendre hommage avec une pièce dansée dont il faut décrypter la signification ?
Dans un décor de Johannes Schütz, des costumes de Joachim Herzog et des lumières d’Alexander Koppelmann, la production comporte un rideau de velours rouge en fond de plateau et un tapis de soie moucheté ; dix-huit danseurs et danseuses, endossant indifféremment selon le sexe longue robe rouge sur body noir et sandalettes à talons dorés, portent chacun un torse de mannequin avec chemise et gilet blancs que l’on va aligner avant de les utiliser pour siège ; une diva et son chef d’orchestre se faufilent furtivement entre eux en quête d’on ne sait quoi, tandis que l’on entend Maria Callas chanter en italien l’Air des clochettes de Lakmé puis, en français, la Valse de Juliette pour faire virevolter les bustes. Ceci constitue ‘In der Oper’, le premier tableau de Callas, pièce dansée conçue en 1983 par la chorégraphe Reinhild Hoffmann pour le Théâtre Concordia de Brême et remontée trente-quatre ans plus tard pour le Ballet du Grand-Théâtre de Genève. S’inscrivant dans l’esthétique du Tanztheater prôné par Kurt Joos, le spectacle ne veut en aucun cas faire œuvre d’autobiographie ; car la diva est une figure culte dont le narcissisme l’a poussée aux extrêmes jusqu’à la catastrophe. Le cadre social doit montrer l’intemporalité du mythe, toujours sur le fil du rasoir entre glamour et misère. Et c’est ce que traduit ‘Zwei weisse Frauen’ basé sur l’entrée et le somnambulisme de Lady Macbeth : efflanquée de sa dame d’honneur (Yumi Aizawa), la méchante reine (Lysandra van Heesewijk) se lave les mains dans le sang avant d’y tremper ses souliers blancs ; affichant son ambition démesurée, elle s’avance ensuite sur un long chemin de papier qu’elle piétine sauvagement en rejetant, voire même en supprimant tout mâle qui tente de s’approcher d’elle. Mais que signifie alors ‘Dressage’ avec ses fouets de dompteur de cirque s’enroulant autour des jeunes filles, ce qui va à l’encontre des sonorités éthérées que Maria modèle pour la Scène de folie d’Ophélie ? Que veut dire cette mascarade incongrue des hommes revêtant leur collègue barbu Xavier Juon d’une écarlate crinoline à faux-cul et d’un large voile puis le hissant sur un couvercle de piano, tandis que l’on écoute admirativement le « Caro nome » de Gilda enregistré à Mexico ? La Habanera et la Séguedille de Carmen ramènent une certaine cohérence, alors que ballerines et danseurs se parent des mythiques costumes de la diva incarnant Medea, Anna Bolena, Amelia du ‘Ballo in maschera’, Violetta ou Amina de La Sonnambula. La folie de Lucia voit la chanteuse étreindre un mannequin à taille humaine, valser avec lui puis se jeter sur lui. Elle arrache ensuite le rideau de scène sous lequel se glissent des masques, le traîne avec elle et s’en enveloppe. « Divinités du Styx » tourne à la ronde grotesque, « J’ai perdu mon Eurydice », à l’avancée de la mariée dont la traîne interminable est saisie par les mains des convives pour constituer une table. Dans un bar en goguette, comment imaginer l’écoute du 78 tours de la pauvre Foster Jenkins ânonnant les clochettes de Lakmé, tandis qu’un ballon rouge est enfoncé dans le soutien-gorge de l’artiste ? Pendant qu’une balançoire sert de métronome à l’entrée de la Leonora d’Il Trovatore’, la divine est parée de vert pour entrouvrir une dernière fois le rideau et conclure au moins sur une belle image. Mais, sous un tel fatras, où étais-tu donc, Maria ?
Paul-André Demierre
Genève, Opéra des Nations, 11 octobre 2017