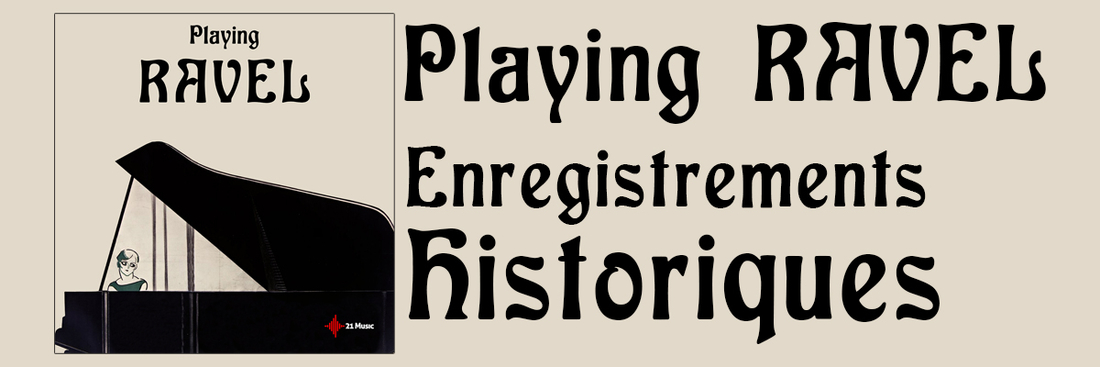Urban Nature, c’est le thème du festival Ars Musica, dont le compte-rendu des concerts que j’ai pu voir arrive avec le décalage fomenté par une infection respiratoire plus résistante qu’un poilu de tranchée.
Samedi, c’est Satie ça te dit ?
Je démarre ma pérégrination biennale par une incursion aux Brigittines pour le concert de François Mardirossian, auquel je tiens d’autant plus que j’ai apprécié son (double) album Satie et les Gymnopédistes, paru il y a peu chez Ad Vitam : là comme sur la scène de la chapelle, le jeune pianiste, enjoué (il raconte, décrypte, empoche le public) et doué (un jeu souple et vivant, aux humeurs manifestes) parcourt le répertoire du compositeur d’Arcueil, une musique minimaliste avant l’heure, aux mélodies claires et aux harmonies dépouillées, aux titres d’un humour excentrique, une musique innovante et aux atmosphères évocatrices -Gymnopédies et Gnossiennes, bien sûr, mais aussi la New Gnossienne n° 1 de Gavin Bryars (un fan du Français, qu’il a contribué à faire connaître au Royaume-Uni), fruit d’une commande du festival Superspectives, ou la Danse pour un enterrement n° 2 de Claire Vailler, création imaginaire d’une pièce dont Satie n’a laissé que le titre. La salle est pleine, ravie et découvre, en bis, Listen To The Quiet Voice, morceau solennel et désarmant du regretté Dominique Lawalrée, compositeur et collaborateur de Crescendo-Magazine que Mardirossian s’acharne, dans un plaisir partagé, à faire émerger de l’obscurité.
La ville, c’est en Amérique du Nord
La même soir, à Bozar, le programme du concert d’ouverture d’Ars Musica, confié au Belgian National Orchestra dirigé par Antony Hermus, surprend : fougueux, populaire, nord-américain d’un bout à l’autre, puisant sur plus d’un siècle de répertoire. Pourquoi pas, sauf que l’ardeur du premier mouvement, Lex, de la Metropolis Symphony de Michael Daugherty (une ode aux cinquante ans de Superman – Lex Luthor est son ennemi juré – par un habitué des Grammy Awards), aux sifflets à bille énergiques martelant un rythme de course poursuite urbaine, cache difficilement l’ambiguïté du populaire -un terme qui désigne une musique accessible et appréciée d’un public large, mais aussi si limpide qu’elle manque des défis qu’une audience vigilante attend d’une musique « nouvelle ». Je me perds dans une orchestration qui se veut complexe mais que j’entends touffue, si contaminée par ses emprunts au jazz, au funk ou au rock, que je la reçois comme une pâtée disgracieuse où l’effet, à chaque tournant, l’emporte.
La Canadienne Keiko Devaux, élève de Salvatore Sciarrino (et boxeuse), s’en sort bien mieux, qui propose, avec Fractured Landscapes, une pièce superposant tradition et modernité, juxtaposant moments de tension/résolution et clusters mouvants, textures bruitées et tonalités pures, image de l’incessante adaptation du vivant (ici, les végétaux qui densifient leurs graines pour améliorer l’efficacité reproductive de leur chute) aux environnements urbains -une manière de survivre, bien sûr, mais aussi de façonner le paysage de la ville-, dialogue éclairé entre l’Urban et la Nature.
Le Concerto pour deux pianos et orchestre de Philip Glass, confié à Katia et Marielle Labèque, qui l’ont créé en mai 2015 à Los Angeles (une étape parmi de multiples collaborations), est un moment attendu : tant le compositeur américain que les pianistes françaises ont pris soin, lors de leurs carrières respectives (et presque aussi longues), de ne pas s’enfermer dans un répertoire -le premier fraye avec Steve Reich aussi bien qu’avec Patti Smith ou Aphex Twin, les secondes interprètent György Ligeti, Luciano Berio ou Pierre Boulez (« jouer de la musique contemporaine est une façon de rester vivante, de rester avec son époque ») comme du baroque ou de la musique expérimentale. La pièce, ambitieuse, a les épaules larges, ne manque ni d’emphase ni de puissance, mais le premier mouvement tripatouille, on n’est pas en place, c’est brouillon, on entend mal le doublement des figures des pianistes par les sections de l’orchestre, la continuité de la ligne mélodique ou rythmique, la tension sur scène est palpable -piquant alors que l’approche de Glass quant au concerto s’est peu à peu éloignée du soliste héroïque qui vainc l’orchestre pour aller vers une conception dans laquelle l’orchestre devient une extension du soliste-, avant un ajustement progressif qui sauve les deux mouvements suivants et rend aux sœurs Labèque la fluidité virtuose de leur jeu.
Je ne sais que penser du déferlement sonore de Play - Level 1, d’Andrew Norman, où le tapageur le dispute au tumultueux : lui y voit un débordement d’idées (sur la technologie, le libre arbitre, Internet, le drone guerrier, le jeu vidéo…) quand j’y entends un borborygme sans tête.
Entre An American in Paris et Central Park in the Dark, de deux compositeurs également imbibés de l’atmosphère de la ville tentaculaire aux innombrables taxis jaunes, je préfère de loin la pièce de Charles Ives : dans cet exemple précoce (1906) de collage musical, le compositeur hume la nuit du grand parc new-yorkais, là où nature placide et ville excitée cohabitent comme elles peuvent, partagées entre calme (les cordes, répétitives et hypnotiques) et chaos (les fragments de mélodies populaires, les klaxons) ; dans une esthétique qui allie jazz américain et musique classique européenne (le saxophone, les trompes des taxis, les syncopes, les blue notes), réussie mais à laquelle je n’ai jamais accroché, George Gershwin, né à Brooklyn et travaillant à Tin Pan Alley, le quartier des éditeurs de musique, raconte, en 1928, ses expériences de la vie parisienne : le BNO se donne dans ce poème symphonique coloré et effervescent, enchaînant les sections dans un flux ininterrompu.