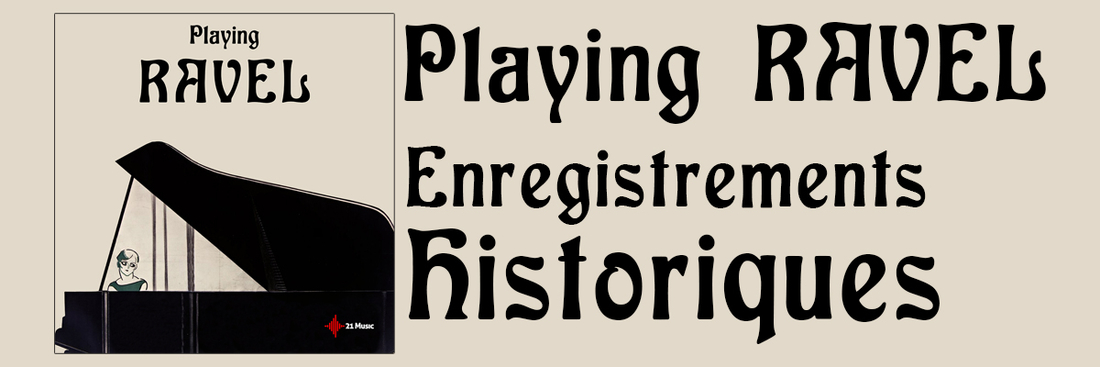Interviews
Le chef d’orchestre Alexander Liebreich vient d’être désigné directeur musical de l'orchestre symphonique de Taipei (TSO). Un développement passionnant dans une carrière internationale que Crescendo-Magazine suit avec attention tant les projets initiés par le chef se révèlent inspirants et exemplaires d’une vision artistique. Crescendo-Magazine est heureux de s’entretenir avec ce formidable musicien.
Vous venez d'être nommé Directeur musical de l'Orchestre symphonique de Taipei (TSO). Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter ce poste ?
Les critères les plus importants pour prendre une décision sont de voir un espace de développement et la preuve de valeurs culturelles. Quand on m'a posé la question, j'ai également été surpris. Ma collaboration avec le TSO a commencé il y a déjà 17 ans, nous sommes deux partenaires qui se connaissent déjà depuis un certain temps.
D'un point de vue géographique européen, nous ne connaissons pas très bien la scène orchestrale taïwanaise. Quelles sont les qualités de l'Orchestre symphonique de Taipei (TSO) ?
Taipei et le National Concert Hall sont depuis de nombreuses années un pôle important de la scène musicale classique. De grands solistes, ensembles et orchestres y ont fait de nombreuses tournées. Ces dernières années, les orchestres de Taïwan se sont installés au National Concert Hall, simplement parce que de nombreux jeunes musiciens ayant étudié à l'étranger sont revenus à Taïwan. De plus, le système éducatif accorde une grande importance à la musique, aux arts et à la culture sous toutes leurs formes. Les orchestres symphoniques sont devenus des institutions importantes grâce à la confiance retrouvée et à la saine ambition des musiciens taïwanais.
Quel sera votre projet artistique pour cet orchestre ?
Le TSO a un concept de programmation clair qui consiste à combiner le répertoire classique avec la musique nouvelle. À côté de cela, nous avons des projets d”opéras. J'ai beaucoup travaillé en Asie - nous devons inclure des artistes, des solistes et des compositeurs asiatiques de premier plan.
Vous êtes le directeur musical de l'orchestre symphonique de Valence en Espagne, une ville qui a été frappée par de terribles inondations. Comment un orchestre peut-il aider la population en ces temps difficiles ?
La ville et ses habitants sont encore sous le choc. La communauté valencienne a réagi de manière solidaire, et cette solidarité a été et est toujours très forte dans toute l'Espagne. La musique peut aider, tout comme le contact social. Je me sens très proche de nos musiciens, certains membres de notre orchestre ont perdu leur maison ou d'autres biens nécessaires. Je suis très touché par la forte empathie du peuple valencien.
Vous avez occupé le poste de directeur musical dans de nombreux pays (Pologne, Espagne, République tchèque, etc.) et maintenant en Asie. Vous décririez-vous comme un globe-trotter musical ?
Bien sûr, je voyage beaucoup, mais en réalité, je tourne en rond depuis 25 ans. L'Asie a toujours été en équilibre avec l'Europe. La Corée, le Japon, la Chine et Taïwan m'ont toujours beaucoup intéressé depuis mes études. L'Europe de l'Est, en raison de mes propres racines en Moravie, est également devenue un espace artistique important pour moi. Les États-Unis n'ont jamais suscité un intérêt plus grand... Je suppose qu'il y a des développements et des énergies naturelles et logiques.
Directeur musical de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), Ludovic Morlot amorce une série de concerts en tournée : Madrid, Lyon et Aix-en-Provence ce printemps, avant Amsterdam, l’été prochain. Crescendo-Magazine est heureux de rencontrer ce chef d’orchestre pour parler de son travail avec l’orchestre et de ses nombreux projets d’enregistrements qui font de l’OBC l’une des phalanges les plus actives du moment.
On dit que, avec La Valse, Ravel aurait fermé le cycle de vie de cette forme musicale et de la société qui la nourrissait. Croyez-vous qu’il ait aussi fermé le cycle de vie de l’orchestration du XIXème ou qu’il ait, en revanche, ouvert la voie à l’orchestre des XXème et XXIème siècles ?
Je crois que l'intention de Ravel, en écrivant La Valse, était d'honorer la valse viennoise, de lui rendre hommage. Ce sont les circonstances de la guerre qui feront que l’œuvre soit devenue quelque chose de très différent. On l'entend bien au début : on peut imaginer les couples dansant et cet élan viennois restera jusqu’au milieu de la pièce. La guerre, qui en a interrompu l'écriture, a fait que graduellement la violence prenne le dessus. On y entend une musique de belligérance, comme dans le Concerto pour la main gauche, qui est très semblable, mais je pense que la guerre a juste fait changer le focus d'écriture de la pièce. Je dirais plus : Ravel, pour moi, n'a jamais été un grand novateur. Il est un peu le Mozart du XXème siècle, celui qui a utilisé tous les ingrédients qui étaient à sa disposition et qui les a rassemblés avec une perfection absolue. À mon avis, le Prélude à l'après-midi d’un faune est beaucoup plus influent sur la direction de l'orchestre des XXème et XXIème siècles que n'importe quelle pièce de Ravel. C’est vrai que dans L’Enfant et les sortilèges, le Concerto pour la main gauche ou même dans L’heure espagnole il a poussé la forme assez loin, mais jamais autant que Debussy. Je pense à Ravel comme un prodige qui ne va jamais créer un ingrédient nouveau : il va faire de la belle cuisine avec des ingrédients qui sont déjà en place, mais sans inventer une nouvelle recette. Pour moi, le révolutionnaire a été Debussy, précédé par Schumann, Berlioz, Sibelius et notamment Liszt, avec ses Poèmes symphoniques, et Wagner. Ce sont eux qui ont trouvé l’élan vers un orchestre réellement novateur. Ravel s’est plutôt tourné vers la musique ancienne : si l’on pense au Tombeau de Couperin ou aux Valses nobles et sentimentales, on retrouve cette influence de classicisme ou du baroque, alors qu'avec Debussy la forme musicale a explosé.
Le fabuleux succès du Bolero et la luxuriance de l’orchestrateur Ravel n’ont-ils pas caché la véritable sensibilité et le talent de l’artiste ? Et aussi son intérêt pour les causes des oppressés comme dans les Chansons madécasses, les Grecques ou les Hébraïques ?
On sait qu'il détestait Bolero. C'était un exercice pour lui mais qui s'est transformé en chef d'œuvre. C’est exactement l'essence du talent de Ravel : cette espèce de nonchalance dans l'idée de créer quelque chose d'original qui est fait avec une telle maîtrise et une telle perfection que ça devient « le chef d'œuvre ». Il y a cet état d'esprit dans sa musique, mais je n’ai jamais pensé comme ça à propos des chansons populaires, des mélodies grecques ou des hébraïques. Je ne sais pas s'il voulait vraiment traiter ces sujets avec beaucoup de profondeur et je ne suis pas sûr qu’il y ait une forme de provocation. Il peut y avoir un « air du temps », une volonté de trouver une l’esthétique musicale en s’appropriant de ces textes.
On a un peu la sensation qu’il voulait faire un pied de nez à une société très conservatrice, antidreyfusarde etc.
C’est vrai que L’heure espagnole est provocatrice avec cette espèce de montée du féminisme et aussi dans L’Enfant et les sortilèges, il y a cette appropriation du jazz. On ne peut pas traiter ces sujets de façon complètement naïve, il faut donc le considérer. C'est là qu’on aimerait mieux connaître la personnalité de Ravel. Par exemple, quand on va à Montfort-l'amaury, il avait tous ces petits « netsuke » japonais à l’aspect très soigné, mais si l’on est très attentif, on s’aperçoit que c'est tout en plastique, comme du toc « made in China » Je ne sais pas à quel point il était sarcastique. Poulenc l’était certainement, mais votre remarque va me rendre plus curieux quant à la pertinence de ces textes par rapport au contexte géopolitique de l'époque.