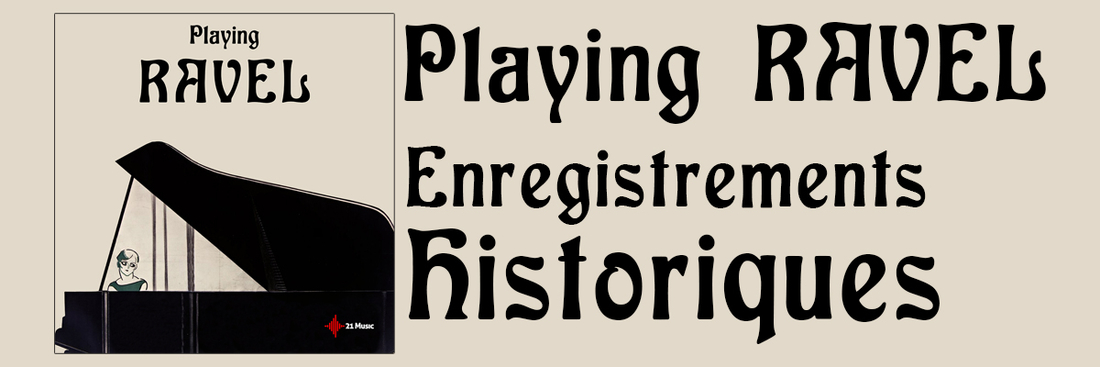Donaueschinger Musiktage 2023, plus ouvert, plus international, plus découvreur
Biotope et hiérarchie : l’évolution en marche
Il reste un léger crachin (un simple effluve humide en comparaison des trombes qui, hier sur l’autobahn, épuisaient mes essuie-glaces), qui n’empêche pas de flâner le long de l’eau, vers le Museum.Art Plus, sa Porsche 911 désossée et dorée (une exposition annexe commémore les 50 ans de la 911 Carrera RS 2.7.), ses sculptures monumentales et multicolores, sa Vespa spaghetti délirante et l’installation sonore de Marina Rosenfeld (1968-), compositrice de Brooklyn (New York), qui aborde de façon louvoyante certaines questions existentielles relatives à la musique et au compositeur, et touche le spectateur sur le triple plan auditif, visuel et affectif -du concept à la réalité, se concrétisent, dans deux pièces à l’étage, plusieurs paires de haut-parleurs posés au plancher diffusant des sons sporadiques, aux côtés de deux micros, de panneaux colorés et de feuilles, de papier et de soie, arrangés, disposés, et autour desquels on déambule, à la recherche de ce fil souvent tortueux, qui lie l’idée à sa concrétisation.
De l’idée à la concrétisation, l’artiste est rarement seul : il vit en interaction avec son environnement, et ses intuitions, ou son travail, ou les unes et l’autre, ne naissent ni se ne développent sans interdépendance avec son biotope : l’édition 2023 des Donaueschinger Musiktage (qui se charge aussi de présenter les œuvres décalées suite à la pandémie) s’intéresse à la collaboration, de la création de l’œuvre à son exécution (des processus pas toujours distincts eux non plus -l’improvisation en est l’exemple le plus évident), dans l’usage des technologies ou de l’espace, dans les rapports avec l’auditeur- s’éloignant délibérément de la structure hiérarchique en musique savante, fondée sur une prééminence en cascade : celle du compositeur sur l’exécutant, du chef sur l’orchestre, de la musique sur le public ; de l’ingénierie sur l’artistique. Au fond, nombreux sont ceux qui interviennent entre l’étincelle (enfin…) créative et la réception dans les oreilles de l’auditeur des sons imaginés : l’interprète bien sûr, mais aussi l’acousticien, l’architecte de la salle de concert, le facteur d’instrument, l’auteur des notes de programme…
Symphonie pour 220 haut-parleurs et geyser vocal
La Symphony No. 3 de Wojtek Blecharz (1981-), polonais installé à Berlin, s’écoute dans une formule qui bouscule la tradition du concert, à mi-chemin entre celui-ci et l’installation : ça se passe dans le (petit) hall des sports Erich Kästner, aux fonctionnelles lignes de couleurs sur le sol balisant ses utilisations multiples (basket, volley, mini-foot…), au long de certaines desquelles sont alignés 220 haut-parleurs sans fil, éteints -longues chaussettes jaune fluo, agenouillé, accroupi, glissant sur son séant, le compositeur les allume au fur et à mesure. Les petits appareils envahissent notre vie courante, alors pourquoi pas en remplacement des interprètes : Blecharz voit ces petits cylindres de plastique et de métal comme autant de semences d’un jardin sonore qu’il construit, plantant l’une après l’autre, graines de résistance à la hiérarchie patriarcale de l’orchestre symphonique -avec ce délicieux paradoxe, qui délivre des instructions (des recommandations) à l’auditeur (marchez lentement entre les haut-parleurs, asseyez-vous ou couchez-vous, changez trois fois de position…) sur la façon d’exercer sa liberté : « le son est la carte, marcher est écouter » ; l’expérience instruit, dégrossit la position traditionnellement passive de l’audition symphonique, s’inscrit dans la fin d’une journée bien nourrie -même si la qualité sonore de minuscules enceintes Bluetooth ne vaut pas la présence acoustique des instruments.
Plus tôt dans l’après-midi, je découvre Die Hochstapler, un quatuor franco-italo-allemand qui fait de la composition un travail collectif et oral (eh bien, comme la plupart des groupes de rock en somme) : This Is Just to Say, construit au fur et à mesure des répétitions avec le souci de la participation et de l’égalité (ça, c’est moins rock), se joue sans partition, se joue du texte comme source de structure sonore, se joue de la voix comme d’une argile à sculpter -ce à quoi s’emploie l’étonnant Mat Pogo, un des trois invités, qui fait éclater des bulles vocales à la surface du son, comme l’eau d’une fontaine de jardin japonais- et il y a aussi les dialogues avec Cristina Vetrone (et son accordéon) et les sonneries d’Antje Vowinckel, le tout puisant dans le jazz et le traditionnel : des Imposteurs, mais chatoyants.
De Clara Ianotta à Eliane Radigue, un demi-siècle et une créativité insolente
La file à l’entrée se constitue tôt (pour tous les concerts, le placement est libre et certains tiennent à se classer en pole position) et, un peu avant 20 heures (belle organisation, on commence à temps et le programme est respecté), dans la Baarsporthalle quasi remplie (à peine quelques places éparses ou en tribune), ça bruisse, un peu plus que d’habitude, de l’excitation du grand orchestre (la scène, pourtant large et profonde, est encombrée), soutenue par l’événement qu’est en soi la nouvelle composition d’Eliane Radigue (°1932), Occam Océan Cinquanta, œuvre collaborative s’il en est, puisqu’écrite à quatre mains avec Carol Robinson (1956-), franco-américaine elle aussi (Radigue a 91 ans et ne voyage plus), complices depuis 2006 et une première association pour Naldjoriak, alors entre compositrice et clarinettiste, relation grandie depuis au travers du cycle Occam, jusqu’à la co-composition à partir de 2015 (pour Occam Hexa II, suivi d’autres pièces) -où Robinson assure la préparation et le travail sur place. C’est elle qui dirige, chaussures qui scintillent, d’une main ondulante, au travers de gestes à la circonspection performative (la musique se meut à leur image), la cinquantaine de musiciens du SWR Symphonieorchester : après une entame violente mais laconique, les sons montent au rythme d’une marée océanique, une émergence lente, peu à peu enrichie (frottements de peau, ténus tambourinements de maillets, déplacements félins d’archets, caresses cajoleuses de bol tibétain), qui mène à une écoute délivrée du temps, dilatée, portée par les variations infimes des composantes sonores -les sensibles à la philosophie religieuse auront le bouddhisme en référence, tous glissent dans une sorte de contemplation pénétrante, comme une exaltation dénuée d’excitation.
L’excitation n’est pas indispensable et j’aime cette délicate sensation retrouvée à l’écoute de la musique de cette ancienne collaboratrice des Pierre, Schaeffer et Henry, mais je me passionne encore plus quand elle montre le bout de son nez, comme avec le duo Rage Thormbones, trapu et invincible, vu l’an passé ici même (Clara Ianotta (°1983), touchée par le Covid, est alors absente -elle a revu sa pièce depuis) : ongles peints et sourdines à la main, Mattie Barbler et Weston Olencki portent where the dark earth bends, le souffle maître des vibrations sourdes puisées dans leurs trombones, mêlé aux frottements de l’orchestre, métalliques (cymbales, feuilles et truelles à l’archet, cordes du piano) ou étouffées (polystyrène, boîtes en carton), aux apports aussi ténus que construits des harmonicas, crécelles et autres petites percussions ; dans cette pièce à la force subtile, il y a du mystère, de la menace, une hallucination sidérale.
Pour Elegy for Tyre: "Welcome to the World through my eyes...", de Matana Roberts (1978-) -cape en vinyle, masque rouge et noir aux oreilles de chat-, l’orchestre, outre la scène principale, est éclaté en petits groupes, sur les côtés et en arrière de la salle : la pièce, écrite sur base d’une partition textuelle de son invention, accumule un amas volontairement confus de sons dissonants et spatialisés, parfois interrompu de syllabes scandées, en hommage à Tyre Deandre Nichols, une récente victime afro-américaine tombée sous les coups de la police lors d’un simple contrôle routier.
Même si elle me convainc moins, Sugarcoating #4, de la Croate Sara Glojnarić (1991-), quatrième et dernière pièce du cycle, est le fruit d’un travail original mené à partir d’une recherche dans la base de données Million Song Dataset (elle recense métadonnées et fonctionnalités audio récoltées à partir d’un million de morceaux de musique populaire contemporaine) : la composition, dominée par les percussions et les cuivres, avance au rythme de percées rapides et sèches, de roulements de tambours pressés, d’incisions de trompettes hachées et meurt comme elle vit -sur un cut brutal.
Collaboration texte et musique
C’est par un programme (collaboratif) en 2 x 2 pour l’Ensemble Ascolta, que débute la journée de samedi, à la salle Mozart des Donauhallen, le QG du festival, avec les années plus fourni en stands d’éditeurs de partitions que de disques (l’exposition est dédiée aux partitions des œuvres créées au Donaueschinger Musiktage, avec un espace dédié à celles de compositeurs non publiés) : Dunst - als käme alles zurück, une composition de l’iranienne Elnaz Seyedi (1982-) sur un texte de la poétesse Anja Kampmann (1983-), lu en allemand et surtitré en anglais, propose de beaux moments au piano préparé, des instants en suspension et un fourmillement de minuscules sonorités ; Was wird hier eigentlich gespielt ? Doppelbiographie des 21sten Jahrhunderts naît d’un échange, débordant d’expériences de vie, entre la compositrice germano-hollandaise Iris ter Schiphorst (1956-) et l’auteure allemande Felicitas Hoppe (1960-), sur les liens, les possibilités et les limites, de la littérature et de la musique : on y retrouve Eurydice, une machine à écrire, de l’humour, la police aux moments idoines, des stop and go, des juxtapositions esthétiques, des cris, de la joie et de l’emphase -un joyeux bazar aux yeux du public ; un tout hétéroclite, imaginatif mais irritant, aux miens.

Représentation belge
Outre le Liégeois Pierre Berthet (1958-), co-créateur, avec Rie Nakajima (1976-), de Dead Plants & Living Objects, une ingénieuse installation bricolée d’objets aux tribulations sonores souvent déclenchées par le fait de s’asseoir sur un siège (certains spectateurs, suspicieux, hésitent face à une hypothétique variante du coussin péteur), visible à l’Orangerie en même temps que celle de Raul Keller (°1973), centrée sur d’élégants ballons, Ictus est l’autre intervenant belge du festival : séparé en deux podiums à chaque extrémité du long hall sportif du lycée de la ville, un grand écran dressé au milieu, support de courts films au flou abstrait (on devine parfois quelques éléments en mouvement) et dans toutes les nuances de gris, l’ensemble bruxellois porte la nouvelle pièce de Joanna Bailie (°1973), 1979, année de ses premiers souvenirs de petite fille, conjugués à l’étrange idée de Charles Babbage et Guglielmo Marconi, non démontrée à ce jour mais avec laquelle la compositrice anglaise d’aujourd’hui joue, qui veut que les ondes acoustiques survivent à leur émission, vagues de plus en plus faibles, de plus en plus infimes au fur et à mesure de leur propagation, s’accumulant dans une sorte de bruit de fond théorique -l’idée est séduisante (les couches sonores se mêlent, s’en vont, se heurtent, reviennent, intriguent et flirtent avec un infini apaisant), le dispositif scénique l’est moins, en tout cas pour les premiers rangs, où l’on se tord le cou tordu pour passer d’une scène à l’autre.
Jessie Marino et les Pinquins
Après un saut, communautaire et agréable, à la Alte Hofbibliothek pour prendre un verre et faire connaissance entre « internationaux », retour aux Donauhallen, cette fois dans la salle Stravinsky, où les haut-parleurs diffusent le commentaire d’un match de tennis, que la performeuse d’origine argentine Emilia Dorr illustre, par ses robustes services ponctués d’onomatopées d’efforts (si retentissantes qu’un spectateur s’en fait un moment l’écho et provoque un éclat de rire partagé). Pour Murder Ballads: Volume II The Positive Reinforcement Campaign, Jessie Marino (°1984), Américaine vivant à Berlin, travaille avec le trio norvégien Pinquins (percussions, électronique, voix), complété de la compatriote contrebassiste Inga Margrete Aas : Marino apporte l’idée globale, un peu de poésie, la métaphore tennistique (un des seuls environnements, selon elle, qui autorise la femme à exprimer sa frustration), des inspirations soniques, quelques scènes ou humeurs, et le groupe crée la chair entre les os ; le morceau se veut un témoin des violences, dans les Appalaches au 19ème siècle et aujourd’hui au quotidien, et puise dans les multiples étapes du féminisme, le folklore (le fiddle joué par la compositrice), la poésie et la tradition orale pour développer une musique éclairée de couleurs et de gémissements, visuelle et gesticulante, non consensuelle.
Yarn/Wire, polyvalent, intense, engagé
En dehors du set tardif d’Elyse Tabet & Jawad Nawfal (°1978), tous deux actifs sur la scène électronique beyrouthine, pour lequel la petite arrière-boutique de la Spiegelsaal affiche complet (une improvisation aux synthétiseurs modulaires et aux échantillonneurs, avec manipulation en temps réel des textures sonores, aux mouvements longs comme des marées), le quatuor new-yorkais pianos / percussions Yarn/Wire fait le lien, en deux concerts intimidants de fougue, de personnalité et d’éclectisme, entre les deux jours du week-end.
Première œuvre au programme de son concert du samedi, For Ross Gay, de Tyshawn Sorey (°1980), un visage à la candeur étonnée sur une carrure de grizzli (il joue du célesta), mêle sections fixes (créées en interaction avec les interprètes, avec des indications sur les instruments, les timbres à explorer, leur qualité et leur quantité) et sections ouvertes (un musicien joue avec -ou contre- un autre, sans spécification de d’instrument ou de timbre), dans une efflorescence sonore en construction, à la fois sereine et rugueuse, parfois déferlante et psychédélique -Ross Gay est un auteur américain dont Be Holding, poème fleuve de la longueur d’un livre, est une méditation prolongée sur un court moment de la carrière du basketteur Julius Erving.
Thinking Holes, de la saxophoniste allemande Ingrid Laubrock (°1970), avec son agrégation de sons fractionnés, de feulements et miaulements félins est moins concluant, mais confirme l’intelligence de jeu de Yarn/Wire -la pièce est semi-ouverte et fait intervenir un haut-parleur transducteur posé sur le piano, responsable d’événements musicaux auxquels les musiciens réagissent-, ensemble qui se déploie de façon étincelante avec Animations, ses parties véloces et percutées de piano, le tournoiement et l’intrication des jets sonores, la cohésion complice avec le soliste (issue de nombreuses répétitions) et, surtout, le jeu époustouflant de Peter Evans (°1981), son compositeur, qui souffle dans sa trompette comme si sa réserve pulmonaire ne connaissait pas de limite, asphyxiant son instrument sans suffoquer, semblant ne jamais reprendre son souffle : renversant !
Le lendemain matin, on sent l’excitation du public à l’idée de retrouver le quatuor, dans la même salle où on a bu hier une bière et mangé un bretzel ou un poulet curry : la compositrice néo-zélandaise Annea Lockwood (1939-) ouvre la journée avec Into the Vanishing Point, une pièce qui parle, de façon non figurative, de l’extinction des insectes, construite collectivement avec l’ensemble autour de sonorités scintillantes et grinçantes, dispersées de façon hypnotique -au point que l’audience met un temps avant de sortir de sa torpeur et commencer à applaudir.
Grain | Stream de Giulia Lorusso (°1990), inspiré par Alchemie, un tableau d’Ansem Kiefer mettant en scène une balance dans le désert et ses pluies de sel et de graines de tournesol, renoue avec l’espoir, au travers d’un monde sonique fait de graines et de flux qui prennent possession des espaces, ondulations et circonvolutions à la fraîcheur et à l’optimisme réjouissants, de celles qui ouvrent à de nouvelles perspectives.
Il faut dépasser le premier degré grandguignolesque (on pense à Daft Punk, en beaucoup moins dansant) de la mise en scène du performeur, de Los Angeles, Bakudi Scream (alias Rohan Chander) -qui raconte, dans In My Heart, and Still et sous l’avatar du Prince Architecte, une histoire d’amour à propos d’un cyborg tragique (déguisé, il en tient le rôle)-, et se laisser glisser dans une musique parfois à l’avenant, parfois faite de boucles cristallines ou de grognements d’ursidés électroniques, pour ne pas quitter son siège après la pause : l’exercice reste grandiloquent, déconcerte et témoigne de la polyvalence versatile de Yarn/Wire ; le public, curieux et ouvert, accepte.
Décisif, Black Dwarf, d’Olga Neuwirth (1968-), fait intervenir globalement trois sources différentes : une recréation des sons de piano préparé de John Cage, un harmonica de verre et deux orgues électriques (avec et sans vibrato ; l’un désaccordé d’un quart de ton par rapport à l’autre) ; les deux percussionnistes sont aux extrémités latérales de la scène, les deux claviers au fond de la salle et cette nouvelle œuvre de la compositrice autrichienne (un pilier du festival, qui la révèle dans les années 1990) développe une puissance fascinante, avec des moments presque violents -qui peuvent incidemment évoquer le groupe expérimental allemand Einstürzende Neubauten (ou, référence plus décalée encore, Le noir de l'étoile de Gérard Grisey).
Trois générations, trois visions, une même quête
Je cherche sans succès l’installation de Ryoko Akama (le GPS situe la Fischhaus au milieu des champs et le temps me manque pour la retrouver par des moyens plus analogique – demander mon chemin, par exemple), me sert un gâteau aux pommes au petit buffet de la réception presse (un journaliste, auprès de qui je déplore ne pas parler sa langue, part d’un grand rire en pointant mon assiette : « Apfelstrudel est un mot qui, ici, vaut la peine d’être retenu… ») et m’installe sur une des chaises en plastique gris, au confort calculé pour des fesses plus rebondies que les miennes, de la Baarsporthalle, pour le concert de clôture avec le grand orchestre du SWR, conduit par Ingo Metzmacher.
Frau, warum weinst Du? Wen suchst Du?, courte pièce de la Sud-Coréenne Younghi Pagh-Paan (°1945), une autre révélation, en 1980 cette fois, des Donaueschinger Musiktage, parle, au travers d’une musique majestueuse (les cordes, simples mais pleines), de la détresse, des larmes, de la consolation qui redonne courage.
D’un charme prenant, comme accidentel, Tune and Retune II, de la toscane Francesca Verunelli (°1979) explore les relations entre timbre et temps, entre temps microscopique (celui du timbre) et macroscopique (celui de l’écoute) : chaque fois qu’on pense avoir saisi l’instant, le voilà qui s’échappe ; les roulés jamais ne s’emmêlent ; les plaintes, les fâcheries, les disputes ombragées, aucune ne résiste au déroulement du temps-et à l’arrêt brutal de ce beau morceau (Verunelli remporte, de façon méritée, le prix de l’orchestre).
Américain, né à Los Angeles (son patronyme ne le laisse pas paraître), Steven Kazuo Takasugi (°1960) structure son Konzert für Klavier, Orchester und Elektronik de près de 50 minutes en 3 moments, 9 parties et 47 sous-parties : la partition est dense (Roger Admiral, piano), l’intervention de l’électronique parfois déséquilibrante (je suis assis devant, à la droite de la salle, sous une colonne de haut-parleurs), les notes, comme une collection hétéroclite qu’on ne rencontre que dans le collisionneur du CERN, se jouent de la pudeur et de la bienséance, capables d’une scansion tonitruante qui se désintègre en un troupeau de canards patauds ; comme dans un crash-test, le choc s’encaisse, déroute, perturbe l’ordre à peine établi -une pièce osée, galvanisante, parfaite pour clôturer une édition renouvelée, découvreuse, inventive.
Donaueschingen, du 20 au 22 octobre 2023
Bernard Vincken
Crédits photographiques : © SWR / Astrid Karger / Ralf Brunner