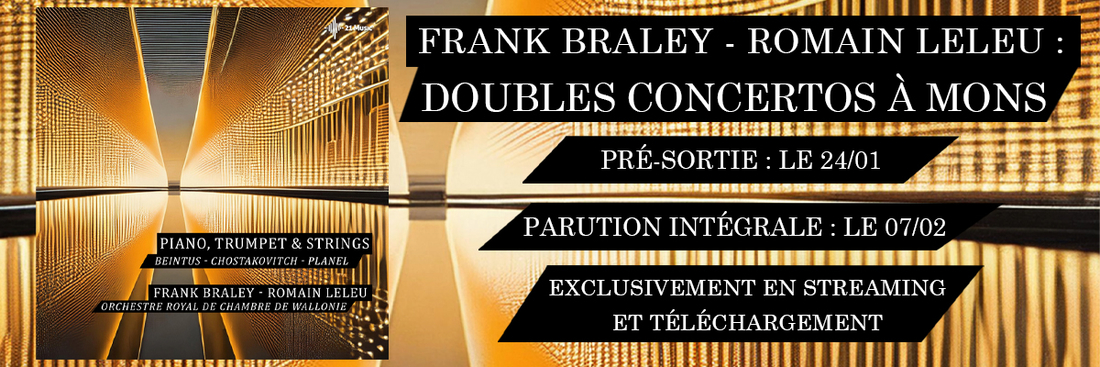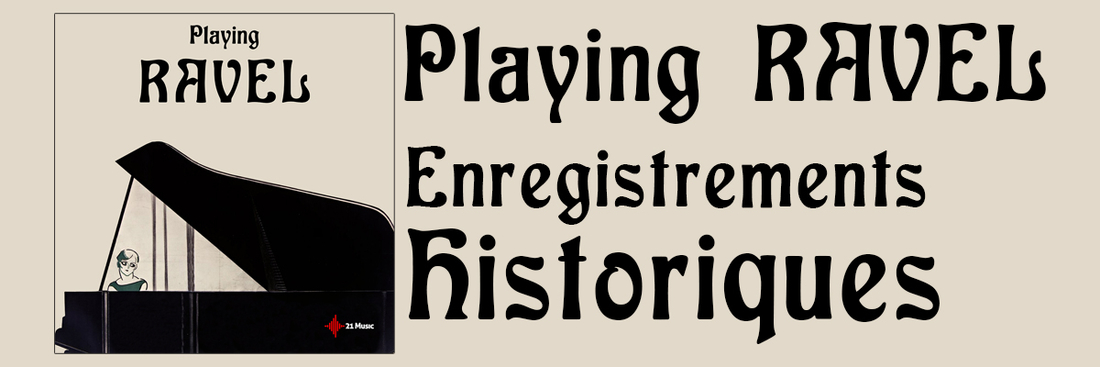Elektre côté Sophocle
Dès la première seconde, le sable de l'arène, les murs clos d'une citerne, les ombres prostrées qui tentent en vain de fuir l'annoncent: les instruments d'une cérémonie sacrificielle où le sang et la mort sont conviés sont ici réunies. Cérémonie d'où les dieux sont bannis. Sacrifice réclamé par l'aveugle destin. Car, c'est du côté de Sophocle plutôt que celui d’Eschyle que penchent la conception straussienne d'Elektra et celle du metteur en scène Robert Carsen. Dans ce huis-clos où nul palais, nulle torche ne distraient de l'obscurité intérieure des êtres, les pulsions primitives se déversent sans que rien ne puisse y faire barrage avant qu'elles se soient épuisées d'elle-même. Au même instant, le fracas des premiers accords met en branle la machine de guerre et l'on sait que, implacable, elle ne s’arrêtera plus avant l'anéantissement final. Cette mise en scène créée à Tokyo en 2005 et à Florence en 2008 (d'ailleurs, le programme annuel devrait ajouter à la mention «nouvelle production»: «à Paris») s'adapte judicieusement aux dimensions de la salle et de la scène de la Bastille . Elle rend compte avec objectivité et fidélité au texte grec, de l'enjeu universel de l'histoire des Atrides version 1909. Sans chercher à expliquer quoi que ce soit, sans recourir aux extrapolations freudienne des mythes grecs -les «Cinq leçons sur la psychanalyse» datent de la même année: les théories psychanalytiques n'ont donc pas pu influer en tant que telles sur la création artistiques, la mise en scène procède par touches crues de noir et de blanc (blanc costume des victimes sacrificielles, Clytemnestre et Egisthe). Le contraste est rehaussé par les superbes lumières de Peter van Praet et par de saisissants déplacements chorégraphiques impeccablement réglés évoquant les pleureuses des vases grecs (Philippe Giraudeau, chorégraphe).
Le chef Philippe Jordan et l'Orchestre de l'Opéra de Paris donnent à cette musique des enfers, tous ses chatoiements et sa monumentalité. Elle évite les brutalités hystériques inutiles et rejoint le caractère stylisé de la conception scénique. On n'en dira pas autant du livret et de la langue anarchique d'Hoffmanstahl qui s'égare souvent dans une esthétique décadente faisant merveille dans sa précédente biblique et moyen-orientale Salomé mais disperse l'attention ici. D'autant que le bariolage précieux ne suffit pas à animer une action malgré tout assez statique.
Mais il est vrai que le grand déferlement straussien des déplorations vocales requiert une «piste d'envol» conséquente. Ainsi, Irène Theorin incarne une Elektra puissante, sauvage, dont on capte au passage de ces moments de magie musicale propres au compositeur notamment dans l'affrontement avec sa mère et qu'on aimerait prolonger. En face d'elle, Waltraud Meier prodigue son chant accompli dans une interprétation qui évoque plus une belle revenante somnambule que le monstre bouffi décrit dans le livret tandis que la féminité lumineuse de Chrysothèmis est portée sans faiblesse par Ricarda Merbeth. Evgeny Nikitin (Oreste) et Kim Begley (Aegist) apportent toute leur densité aux personnages du frère vengeur et de l'usurpateur brutal. Les interventions initiales des servantes placées en arrière-scène sont elles, malheureusement peu audibles.
Du très beau travail au service d'une partition tout à fait singulière dans la production du compositeur comme dans l'histoire de l'opéra.
Bénédicte Palaux Simonnet
Opéra National de Paris, 4 novembre 2013