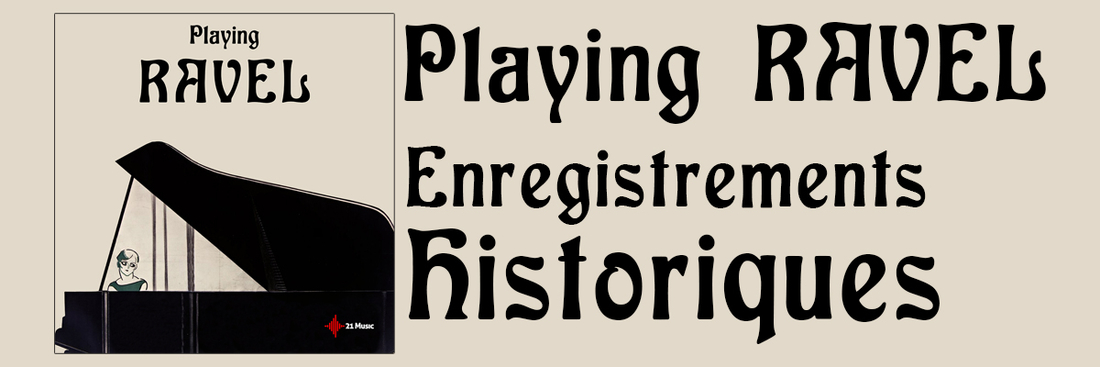Ernani de Verdi à Florence, dans le respect de la tradition
Giuseppe Verdi (1813-1901) : Ernani, opéra en quatre actes. Francesco Meli (Ernani), Roberto Frontali (Don Carlo), Vitalij Kowaljow (Don Ruy Gomez de Silva), María José Siri (Elvira) ; Chœurs et Orchestre du Mai musical florentin, direction James Conlon. 2022. Notice et synopsis en italien et en anglais. Sous-titres en italien, en anglais, en français, en allemand, en japonais et en coréen. 134’ 00’’. Un DVD Dynamic 37972. Aussi disponible en Blu Ray.
Difficile de résister à Ernani ! Au sortir de l’atmosphère sauvage et des accents bibliques de Nabucco et d’I Lombardi, ce mélodrame nous plonge dans une aventure de cape et d’épée menée tambour battant, avec des personnages colorés, cohérents, incroyablement vivants et entiers dans leur passion. La tension est souvent maximale, et l’équilibre hardi entre une musique généreuse et l’urgence d’un théâtre qui ne baisse jamais la garde ; les rythmes, ardents, gonflent les mots de leur sens, et les mélodies sont de vrais trésors : un drame en Technicolor. Cette présentation du cinquième opéra de Verdi, créé à La Fenice de Venise le 9 mars 1844, sort de la plume de Jérémie Rousseau, dans un article du volume Tout Verdi (Laffont, 2013, p. 112), paru à l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur.
Si nous ajoutons à cet éloge la précision que le drame se déroule au XVIe siècle à Aragon et à Aix-la-Chapelle et se joue autour d’Elvira, jeune femme aimée par le brigand Ernani, qui se révélera en réalité être un duc, mais convoitée en même temps par son vieil oncle et tuteur Don Ruy Gomez de Silva, et par le roi d’Espagne Don Carlo, futur Charles-Quint, nous aurons presque tout cerné d’une intrigue qui s’inspire de la pièce de Victor Hugo (Hernani, 1830), à partir de laquelle le librettiste Francesco Maria Piave signa une première collaboration de qualité (il y en aura presqu’une dizaine d’autres) avec Verdi. On sait que tout se termine mal pour le héros : gracié par l’empereur qui lui pardonne sa trahison lors d’une conjuration, il est rattrapé, au moment de la célébration de ses noces, par un serment fait à Silva, qui l’a un jour protégé, de se donner la mort sur un simple appel de cor. Ernani se suicide, abandonnant Elvira à son désespoir.
La présente production, filmée le 10 novembre 2022 en la salle Zubin Mehta du Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, suit fidèlement le récit, dans une mise en scène traditionnelle, pour ne pas dire conventionnelle, que l’on doit à Leo Muscato dont ce n’est pas la première expérience verdienne (Rigoletto, un Bal masqué, I due Foscari, Nabucco). Dans un décor sobre fait de panneaux de grandes dimensions, que l’on peut déplacer ou ouvrir à certains moments de l’action, avec des lumières bien calibrées à dominante brune et bleue, des costumes attrayants évoquent plus la première moitié du XIXe siècle (hommage à l’époque de la pièce d’Hugo ?) que la fin de la Renaissance. On peut savourer une intrigue menée « tambour battant » à laquelle le bon goût a épargné des transpositions contemporaines douteuses, comme les armements et harnachements militaires que l’on a pu voir à l’Opera Ballet Vlaanderen en janvier dernier dans une mise en scène de la Tchèque Barbora Horáková, ou la violence masculine très sanguinolentes dans laquelle s’est enfermée la metteuse en scène hollandaise Lotte de Beer au Festival de Bregenz en juillet.
Ici, l’œil est séduit par un récit qui avance vaillamment, l’intérêt demeurant constant pendant les deux heures de visionnement. Avec peut-être le regret d’un certain statisme dans le jeu théâtral, les personnages, brûlants de passion, étant souvent figés sur place, et les scènes collectives, hautes en couleurs, se résumant à un alignement côte à côte des choristes. L’oreille est séduite, elle aussi, par les flots de musique, énergiquement maîtrisée, que distille le chef américain James Conlon dont on connaît les magistrales interprétations de compositeurs persécutés par les nazis. Verdi lui convient aussi : il allie la fougue, les couleurs et le lyrisme tout en assurant la cohérence et l’unité musicale des quatre actes. Dans la foulée, les chœurs, festifs ou guerriers, sont galvanisés, en particulier dans le morceau de bravoure des conspirateurs Si ridesti il Leon di Castaglia de l’acte III.
Le plateau vocal est de qualité ; il réunit un quatuor de voix chevronnées dans le répertoire verdien. A commencer par la soprano uruguayenne María José Siri, qui incarne une Elvira aux aigus frémissants ; elle sait comment mettre en valeur les accents émouvants et les inflexions réclamées par un rôle à la fois gracieux et tragique dès son aria Ernani, Ernani involami de l’Acte I. Ses vaines tentatives de sauver le héros de son destin sont touchantes. Le ténor génois Francesco Meli, la quarantaine vaillante, est un Ernani héroïque et décidé. Ceux qui connaissent son récital Prima Verdi (Warner, 2021) savent que la projection de la voix et la qualité de la diction sont des qualités qu’il cultive ; on les retrouve ici, bien mises en évidence dès qu’il esquisse un portrait de sa bien-aimée Elvira (Come rugiada al cespite), ou lorsqu’il se croit trahi par elle (Tu, perfida… Come fissarmi ardisci ?).
Le rôle de Don Carlo est dévolu au baryton romain Roberto Frontali (°1958), qui s’est souvent produit sur la scène du Théâtre Verdi de Trieste dans maints rôles du compositeur. Il campe avec noblesse et grandeur le personnage de Don Carlo qui, devenu empereur, sait montrer sa magnanimité en accordant son pardon, après s’être caché dans le tombeau de Charlemagne. Son monologue Oh, de’ verd’anni miei est solennel à souhait. Quant à Don Ruy Gomez de Silva, dont la noirceur et l’esprit de vengeance sont à l’opposé de celui de Don Carlo, c’est l’impressionnant Vitalij Kowaljow (°1968), Ukrainien d’origine vivant en Suisse, qui l’incarne ; depuis qu’il a remporté le Concours Operalia Plácido Domingo en 1999, il s’est illustré dans tous les rôles de basses verdiennes. Remarquable d’un bout à l’autre de l’action, il traverse l’opéra comme une personnalité maléfique, haineuse et sans pitié. Une superbe prestation, avec une scène finale au cours de laquelle son inflexibilité fait froid dans le dos. Le reste de la distribution, qui comprend de petits rôles, est sans failles.
Sur le plan discographique, les plus grands ténors se sont illustrés au siècle dernier dans le rôle-titre, de Carlo Bergonzi à Franco Corelli, en passant par Mario del Monaco. Plácido Domingo et Luciano Pavarotti les ont suivis. Sur le plan vidéographique, il existe déjà un petit nombre de versions que dominent les deux dernières stars citées, Domingo avec Mirella Freni, Renato Bruson et Nicolai Ghiaurov à la Scala sous la direction de Riccardo Muti en décembre 1982 (NVC Arts), Pavarotti avec Leona Mitchell, Sherrill Milnes et Ruggero Raimondi au Metropolitan de New York sous la baguette de James Levine en décembre 1983 (Decca). Ces deux versions indispensables, avec une légère plus-value globale pour celle de la Scala, ne doivent pas faire oublier les mérites, malgré quelques limites vocales, de Ramon Vargas, Svetla Vassileva, Ludovic Tézier et Alexander Vinogradov à Monte-Carlo, menés par Daniele Callegari dans une mise en scène de Jean-Louis Grinda (Arthaus, 2017). A cette dernière, nous préférons toutefois la nouvelle production de Florence, bien filmée sous la direction de Matteo Ricchetti. Mise en scène, solos, duos, ensembles, orchestre et chœurs rendent un bel hommage à la créativité bouillonnante du jeune Verdi.
Note globale : 8,5
Jean Lacroix