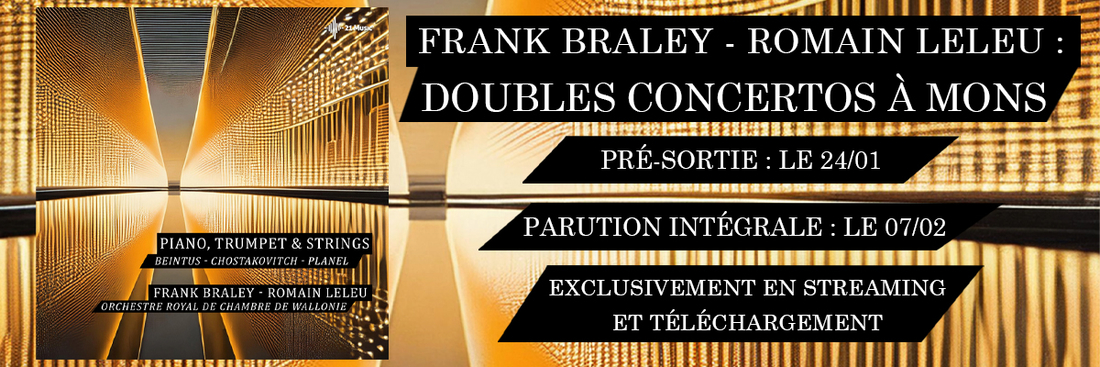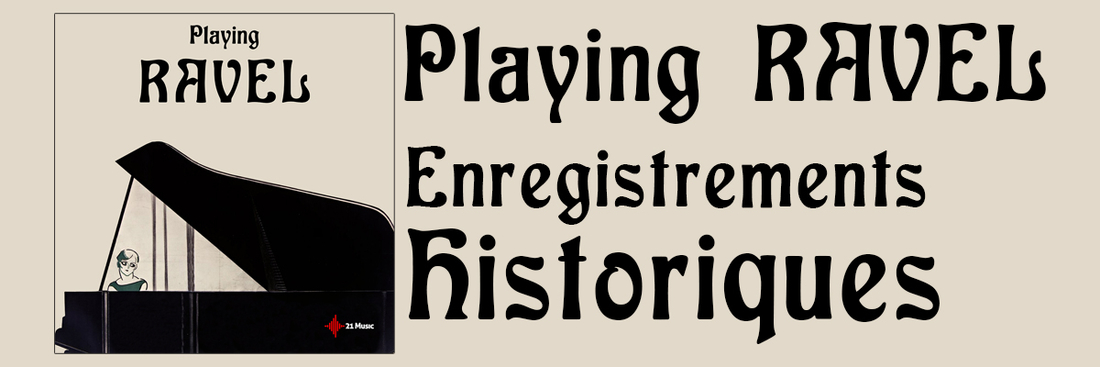La Esmeralda… de Louise Bertin, vraiment ?
De ce spectacle prétendument présenté comme étant « opéra de Louise Bertin », on sort déboussolé.
L’œuvre est devenue un spectacle pêle-mêle dans lequel tout se mélange sans que l’on comprenne pourquoi ni comment.
L’œuvre est composée en 1836 sur un livret de Victor Hugo, par la fille du directeur du puissant Journal des débats, Louis-François Bertin dit Bertin aîné (dont Ingres a fait un magistral portrait en 1832 qui se trouve aujourd’hui au Louvre). Dans sa demeure à Bièvres, à proximité de Paris, il tenait un salon littéraire qui réunissait de nombreux jeunes artistes prometteurs, parmi lesquels Gounod, Liszt, Berlioz (qui écrivait pour ce journal d’importantes critiques musicales), Chateaubriand, et bien sûr, Hugo. L’enregistrement réalisé à l’occasion de la représentation en version de concert donnée sous la direction de Lawrence Foster, au Festival de Montpellier en 2008, montre son écriture originale qui tmoigne avec éloquence de son talent particulièrement florissant.
Mais hélas ! La metteuse en scène Jeanne Desoubeaux a tellement transformé l’œuvre qu’on la reconnaît à peine. Déjà, à l’ouverture, avec une interminable « fête infâme » en rave party avec un défilé grimaçant (imitation de gargouilles ?) sur une musique électronique enregistrée (Gabriel Legeleux) dans une sonorisation à casser l’oreille (François Lanièce) et sous des lumières agressives (Thomas Coux), on se demande à quel spectacle on va assister. Et on vérifie si on a bien lu sur le programme « opéra de Louise Bertin »… Le mélange d’époques dans les costumes (Alex Costantino) et dans la scénographie (Cécile Trémolières) aurait pu refléter une lecture transversale intéressante, mais l’absence de cohérence et la vulgarité de certaines scènes ne font qu’accentuer le sentiment de confusion totale. Si la rosace et une colonne avec chapiteau (qui sont beaux en soi) et l’échafaudage des chantiers qui symbolisent la Cathédrale d’hier et d’aujourd’hui, la généralisation de la lecture est telle qu’on peut à la limite se passer de Notre-Dame, ce qui est fort dommage.
Pianiste et chef de chant, Benjamin d’Aufray a réduit la partition d’orchestre pour cinq musiciens de l’Ensemble Lélio (Lucie Arnal, violoncelle ; Roberta Cristini, clarinette ; Marta Ramirez, violon ; Aline Riffault, basson). Elle s’articule autour d’un « piano romantique » sans mentionner de quel instrument il s’agit. D’ailleurs, pourquoi alors ne noterait-on pas ce terme pour d’autres instruments ? Et que peut-on justifier l’utilisation des instruments d’époque dans une mise en scène qui ne les valorisent point ? Certains airs et duos se transforment en des mélodies de salon. Ils ont certes beaucoup de charme, mais en toute évidence, la version de chambre n’évoque pas la splendide écriture orchestrale de Louise Bertin. Il en va de même pour tout l’opéra : le final spectaculaire de l’acte III et à la fin de l’opéra, avec un coup de timbales qui marque si bien l’esprit, est (bien sûr) absent… Ainsi, dans cette version, il manque cruellement la dimension grandiose voulue par la compositrice à la hauteur de l’édifice. Quant aux récitatifs, ils ne trouvent plus sa fonction et deviennent un objet étrange et à part. En effet, des textes d’Hugo introduits comme récits (dits par Arthur Daniel) et souvent à la place du chœur, suffiraient pour accélérer et expliquer l’intrigue.
Parmi les chanteurs, inégaux, seule Jeanne Mendoche tient la corde vocale. Avec une expressivité tantôt pudique tantôt déterminée, elle incarne son rôle avec dignité. La basse Renaud Delaigue en Frollo impressionne dans un premier temps avec sa projection, mais on se lasse vite avec la rigidité des phrasés. Christophe Crapez avec son chant imprécis ne donne pas d’impact au personnage de Quasimodo. Enfin, le beau timbre de haute-contre de Martial Pauliat, alias Phœbus, est quelque peu gâché par le manque de soutien, notamment dans les aigus. De plus, la mise en scène lui impose une grossièreté indécente… Arthur Daniel précédemment cité dans le rôle de Clopin est un excellent comédien dans les récits, mais l’idée de lui faire chanter des récitatifs ne convient pas musicalement.
La rareté de représentation de cette œuvre nous a probablement donné trop d’espoir et d’attente. Mais avec un tel cafouillis, on voudrait vraiment qu’on indique clairement « une adaptation d’après l’opéra de Louise Bertin ». Attendons maintenant une version plus fidèle à la partition dans une mise en scène sans défiguration.
Paris, Théâtre des Bouffes du Nord, 19 novembre 2023
Victoria Okada
Crédit photographiques : Jean-Louis Fernandez