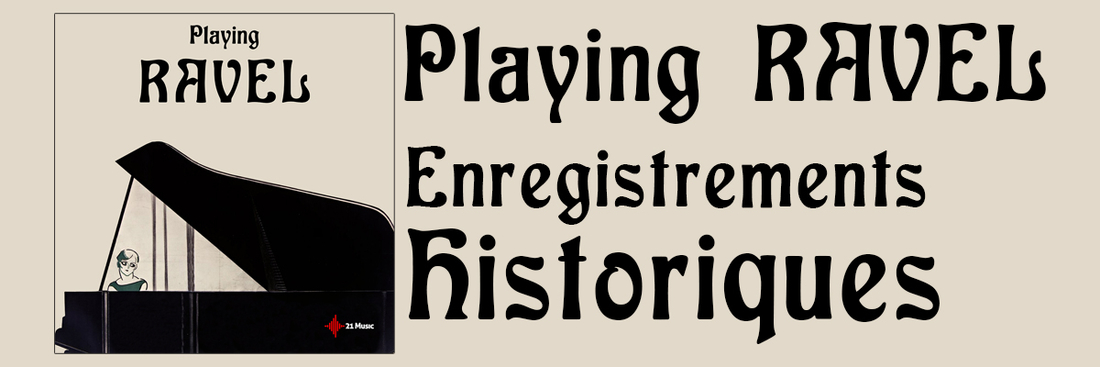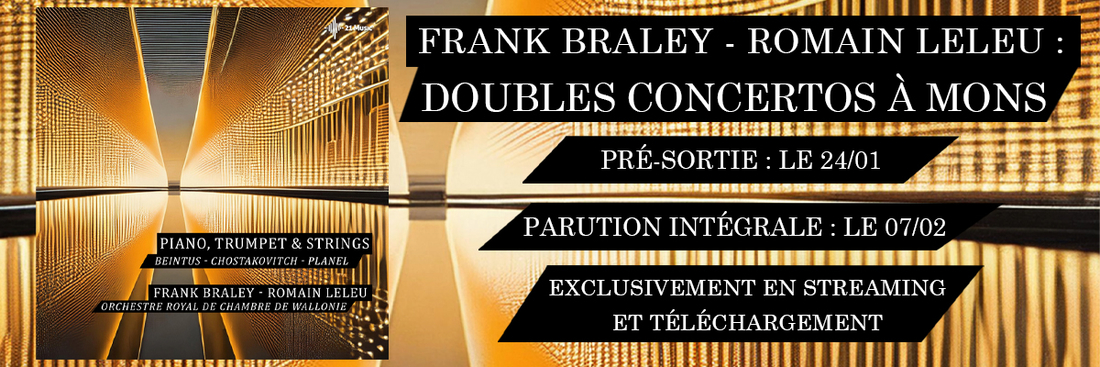Le Maximum du minimal à Luxembourg
« Less is more » est le thème du festival de musique contemporaine de la Philharmonie Luxembourg (jusqu’au 1er décembre), au livret maousse costaud, alternant les langues comme il est de coutume dans ce pays minimal à l’ouverture maximale. La base de la musique minimaliste est un matériau minime, tel l’ADN qui, avec ses seules trois lettres, génère et différencie tout être vivant, ou le binaire informatique, qui code et diffuse, avec de simples 1 et 0, presque tout ce qui se perçoit (Lionel Detry).
Pour Georg Friedrich Haas, dont le Konzert für Klangwerk und Orchester (commande Philharmonie et Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Wiener Konzerthaus, Gürzenich-Orchester Köln et Casa da Música, Porto), écrit pour les baguettes de Christoph Sietzen, est créé ce soir, la forme extrême du « less is more » est le 4’33" de John Cage. Ça se tient.
Ilan Volkov, qui dirige pour l’occasion l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, connaît bien, pour en avoir assuré la première à Glasgow et une deuxième représentation à Stavanger (Norvège), la composition de l’Anglaise Naomi Pinnock qui ouvre le programme de ce soir. The field is woven (2018) trempe ses racines au début des années 60, quand la Canadienne Agnes Martin crée ses White Paintings, joignant la puissance émotionnelle de l’expressionisme abstrait à la pureté d’un espace minimaliste : une structure simple de lignes horizontales et verticales imbriquées dans un format le plus souvent carré. Pinnock s’inspire de ce tissage pour en récupérer le mouvement répété d’aller et retour, d’un côté à l’autre à la façon de la navette du métier à tisser, et explorer de cette manière « les dynamiques délicatement changeantes de l’intimité et de l’espace au sein de l’orchestre ». Et oui, la composition procède par velléités de flux, émergences pointillistes, douceurs amorcées, dérives spatiales. Une esthétique peut-être plus américaine qu’anglaise.
Pour le Konzert für Klangwerk und Orchester (2019), l’avant-scène remonte de quelques dizaines de centimètres, positionnant au niveau de l’orchestre le dispositif scénique inhabituel, royaume exclusif de Sietzen, brillant dans sa chemise rouge foncé et ses bottines cirées. Séparé de l’orchestre par un paravent acoustique en plexiglas, le « mur sonore » qui fait face au public, derrière la rangée de caisses et tambours, littéralement « dispositif permettant de produire du son », est fait d’objets alignés, de tubes, de plaques de différentes matières et formes, à l’ordonnancement structuré -de bas en haut suivant la hauteur et de gauche à droite selon la sonorité. Gongs et bidons (d’un vert et d’un bleu contrastés, aux logos de l’huile qu’ils contenaient dans une première vie pétrolière) complètent cet instrumentarium recyclé. Renommé pour son travail sur les micro-intervalles, Haas revendique être d’abord « … un compositeur et non un adepte de la micro-tonalité » et cette pièce, aidée par le physique de l’exercice qu’impose la partition au percussionniste (souple, contorsionné sur cette surface d’environ 2,5 x 4,5 mètres, frappant -ou plutôt « mettant en résonnance »- de ses baguettes, crissant parfois de son archet), ramène l’émotion dans l’œuvre, remet à l’avant-plan la poétique de l’écriture, la liberté de moyens du compositeur. Une surprise avec un bis de Sietzen seul, ravi d’expliquer son saisissant montage.
Je suis resté insensible au Mestizo (1991) de l’Uruguayen Coriún Aharonián : son analyse marxiste des gestes musicaux comme mécanisme impérialiste imposant des structures culturelles aux pays colonisés ne m’a guère déconcerté. Si j’ai aimé la sonorité des wankaras gigantes (« immenses caisses claires avec plusieurs cordes résonnantes, en cuir ou en fibre naturelle »), je ne peux pas en dire autant du parti pris qui brise chaque amorçage, refuse obstinément tout développement -tout plaisir- et produit un surplace désespérant, escarpé et figé.
Par contre, quel bonheur de retrouver Morton Feldman, pourtant au crépuscule de sa vie -il écrit Coptic Light (1985) deux ans avant sa fin-, la densité de ses textures encore sublimée par l’utilisation pleine de l’orchestre, sollicité du début à la fin sans authentique pause ou respiration pour aucune des sections instrumentales. Feldman indispose la mémoire. Il l’importune, répétant de façon indéterminée, créant une sorte d’écho brinquebalant, testant les limites imparfaites de la production humaine -dont il chérit les structures asymétriques, comme celles des tapis moyen-orientaux qu’il collectionne. On s’y perd si on veut s’y retrouver : les réitérations (au contraire des répétitions, ou des duplications mécaniques) agencent autant de minuscules variations -ni mémorisables ni comparables. Sa musique est une nappe de mercure liquide qui se déploie comme une mare métallique, à la surface immédiate, lisse et lourde. « Je n’ai pas l’impression que ma musique soit clairsemée ou minimale : c’est un peu comme les gros qui ne pensent jamais qu’ils sont gros », déclare-t-il avec humour en 1986. Le maximum du minimal.
Un concert enregistré par Radio 100.7 et rediffusé le 11 décembre 2019.
Luxembourg, Grand Auditorium de la Philharmonie Luxembourg, le 29 novembre 2019
Crédits photographiques : Daniel Delang
Bernard Vincken