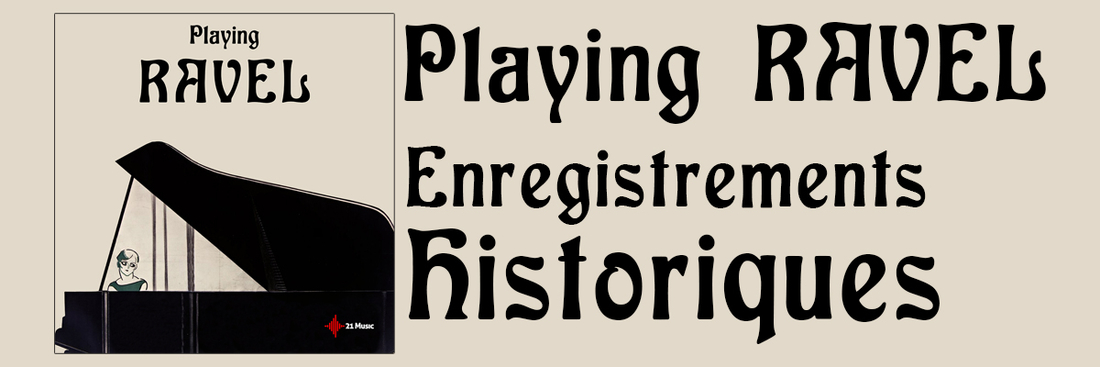Pelléas et Mélisande à l’Opéra de Paris
Scandale à sa création en 1902 sur la scène de l’Opéra comique, Pelléas et Mélisande, drame lyrique de Claude Debussy n’a rien perdu de sa provocante séduction. Comme la lampe d’Aladin, ce chef-d’œuvre d’art français peut facilement se briser laissant son génie s’évaporer puisque sa beauté réside dans sa fragilité. C’est ce que Wajdi Mouawad directeur du théâtre de la Colline exprime dans sa note d’intention : la musique et les voix ont toute leur place et « le reste doit rester indicible, imperceptible, à peine montré ». Grâce à cette compréhension profonde, la splendeur vénéneuse de l’opéra peut se libérer.
Basée sur un argument très simple : le prince Golaud revient au château d’Allemonde avec Mélisande sa jeune épouse qui tombe amoureuse de son frère Pelléas, la partition mélange onirisme et prosaïsme – par exemple Golaud jaloux frappe et traîne Mélisande par les cheveux ou manipule le petit Yniold pour espionner les amants –.
Ici, le compromis entre une approche cérébrale, désincarnée et une autre plus luxuriante penche en faveur de la profusion. Si le goût des décors et des costumes laisse à désirer : tunique rosâtre de Mélisande, sinistre robe de Geneviève, tripes violacées, homme-sanglier poilu, masques hideux, photos lugubres de fleurs séchées… l’efficacité prime.
La scène se divise ainsi en trois zones horizontales superposées. En bas un charnier, au milieu les humains apparaissant et disparaissant à travers des panneaux mobiles et, au sommet, les ancêtres puis le ciel où les amants s’uniront - dénouement rajouté au livret du poète belge Maurice Maeterlinck et qui fait peut-être allusion au panthéisme du compositeur.
Les cinq actes en douze tableaux sont traités dans des coloris verdâtres, gris-bruns, en images floues astucieusement « vues à travers l’eau » - marécages, grottes, forêts, fontaines ou cascades. Parfois, des lambeaux de vapeurs s’élèvent au dessus des cadavres tandis que l’image de Mélisande noyée flotte sur la vidéo. Tout est suggestif, cohérent, en osmose avec les émotions et le paysage musical.
Si l’ajout des chants d’oiseaux, l’homme-sanglier blessé, ou les allées et venues des trois équarrisseurs -brigands pendant l’introduction et les interludes n’apportent pas grand-chose, la judicieuse structuration de l’espace facilite autant la compréhension que le jeu d’acteur. Les déplacements réglés avec précision font évoluer les personnages à distance, comme dédoublés, pendant que le texte de Maeterlinck projeté au fond, met en évidence les bégaiements et les vides allusifs qui déroutèrent tant les premiers auditeurs. Toutes qualités que Debussy recherchait pour ses livrets et qu’il développera huit ans plus tard dans ses « Préludes » (La Cathédrale engloutie par exemple, à laquelle les vidéos de reflets inversés font écho).
Personnage principal, l’orchestre de l’Opéra très concerné se montre sous son meilleur jour, à la fois lyrique et coloré sous la direction du chef turinois, Antonello Manacorda. Soucieux des équilibres, attentif aux chanteurs, ce dernier, en cette soirée de première, privilégie l’architecture et la contemplation par rapport à une tension dramatique qui gagnerait à être plus soutenue
Le couple légendaire chante à front renversé. Autant Pelléas (Huw Montague Rendall) souple comme un jeune fauve offre une incarnation solaire et charnelle, autant Mélisande (Sabine Devieilhe) apparaît figée et hermétique dès sa première rencontre avec Golaud. Ses évolutions de somnambule comme la gracilité du chant produisent un effet de contraste sans doute voulu avec la scène de la Tour et celle de la Fontaine où la voix trouve la lumière. De son côté, le baryton gallois se jette avec fougue dans un rôle qu’il a longuement médité et rend remarquablement cohérent. Les couleurs et la ligne de chant veloutée jusque dans les aigus réchauffent et humanisent un emploi généralement tenu par des barytons Martin ou des ténors excellents diseurs souvent corsetés ou de format vocal modeste.
La scène fratricide des souterrains (III, 2) suscite d’autant plus d’angoisse que Pelléas fait ici le poids avec Golaud (l’imposant Gordon Bintner). Le baryton basse canadien construit un personnage de chasseur, vigoureux et instinctif, plus fiévreux que sadique. L’ancêtre Arkel - pour une fois ni hagard, ni délabré- prend une place intéressante. D’une diction claire, comme celle de toute la distribution, la basse Jean Teitgen lui confère noblesse et humanité ; Geneviève (Sophie Koch) se confronte à une tessiture périlleuse tandis que Le médecin (Amin Ahangaranse) montre de la fermeté dans ses brèves interventions et qu’ Anne-Blanche Trillaud Ruggeri, soliste de la maîtrise de Radio France, déploie avec assurance son timbre ravissant sans que la projection soit suffisante par rapport à la salle. La distribution d’un soprano adulte dans le rôle d’Yniold (comme ce fut le cas après quelques représentations dès 1902 ) se discute : plus sonore, elle prive aussi de l’émotion d’une voix d’enfant. Les chœurs, enfin, restent agréablement discrets lors de leurs courtes interventions.
Le public salue avec enthousiasme cette plongée dans les grands fonds de la musique française, riche en émotions, sensations, réflexions. Une mise en scène de référence.
Paris, Opéra Bastille, 28 février 2025
Bénédicte Palaux Simonnet
Crédits photographiques : Benoite Fanton / Opéra de Paris