Premières représentations scéniques en Espagne de Mitridate, Re di Ponto de Mozart
Mozart en première espagnole en 2025 ? Cela peut surprendre, certes, mais ce laps de temps nous semblera plus raisonnable si l’on considère que la première fois qu’on a pu voir ou entendre cet ouvrage, après sa création en 1770, fut à Salzbourg en 1977. En Espagne, plusieurs versions de concert ont vu le jour, notamment avec Mark Minkowski au Teatro Real, mais aucune scénique. On rappellera aussi que l’opéra a vécu des temps difficiles entre la guerre civile 1936-39 et la disparition du dictateur Franco en 1975 car… il détestait cet art ! Ce magnifique bâtiment qui est le Teatro Real a été dédié pendant toute cette période uniquement au concert et servi aussi de siège au Conservatoire Supérieur de Madrid. L’opéra subsistait avec des difficultés à Barcelone et occasionnellement en province. L’on avait confié la restauration à l’architecte José María García de Paredes, (qui était marié à la nièce de Manuel de Falla) et il a fait en sorte que les exigences de l’opéra restent possibles en vue d’une ultérieure remise en état en tant que maison d’opéra, notamment pour sa gigantesque cage de scène.
De nos jours, Mitridate fait inlassablement l’admiration des mélomanes par la précocité de l’auteur. Il me semble, néanmoins, que nous devons faire abstraction de son jeune âge pour considérer la manière absolument magistrale avec laquelle Mozart utilise des éléments de dramaturgie musicale pour souligner les états d’âme extrêmes des protagonistes dans ce contexte d’ambitions politiques et trahisons amoureuses qui en constituent la trame. Des ruptures harmoniques, des modulations soudaines ou des chromatismes inusuels jalonnent un discours musical parsemé d’airs magnifiques, dont se détache la prodigieuse beauté et le dramatisme de cet inoubliable « Nel grave tormento » confié à Aspasia. Le compositeur devait compter avec une distribution de tout grands virtuoses car il est presque impossible d’y trouver un air « facile » où les embûches virtuoses n’en remplissent au moins les deux tiers. Il est vrai aussi que le discours dramatique n’est pas encore tout à fait accompli et que le dénouement prévu par Vittorio A. Cigna-Santi en forme de « happy end » n’améliore en rien le drame absolu de l’original de Racine. Il semblerait aussi que Mozart n’ait eu le moindre échange avec le librettiste, se bornant à démontrer qu’il était capable d’en écrire la musique. Nous sommes loin de la complicité future avec Da Ponte ou Schikaneder dont découleront des monuments théâtraux insurpassables. L’anecdote avec la « prima donna » Antonia Bernasconi est savoureuse : elle avait exigé pour son rôle de ne chanter que les airs d’Aspasia du « Mitridate » de Gasparini qu’elle avait déjà présenté en public. À un certain moment des répétitions, elle a voulu connaître la musique que l’adolescent autrichien lui avait écrite. Stupéfaite… elle a vite appris les airs de Mozart pour les chanter à la première…
La production madrilène a été confiée scéniquement à Claus Guth, un habitué des textes mozartiens, avec des décors de Christian Schmidt, évoquant un intérieur cossu des années 60 qui pourrait nous rappeler ceux du film « Mon oncle » de Jacques Tati, et un autre espace totalement abstrait, qui tourne comme un miroir entre réalité et introspection psychique. Une chorégraphie absolument cruciale signée par la californienne Sommer Ulrickson apportera une vue en miroir ou en kaléidoscope à des personnages tiraillés entre l’ambition politique et la trahison familiale : Aspasia est promise à Mitridate, mais convoitée par ses fils Farnace e Sifare, qui s’intéressent l’un au pouvoir et l’autre au cœur de sa bienaimée. Guth a déclaré à la presse : « L’« opera seria » est considéré comme un format rigide et schématique. Mais lorsqu’on approfondit un peu, on découvre dans les « Arie » un tréfond psychologique très complexe qui ouvre des énormes espaces mentaux et émotionnels. » Guth et son équipe parviennent à en extraire un récit fluide et à nous offrir des moments d’une beauté plastique transcendante au moyen d’une approche visuelle très fouillée du mouvement et d’un jeu d’acteurs très subtil et diversifié qui fait oublier les longueurs d’une partition de plus de trois heures. N’empêche qu’une partie du public a copieusement hué l’équipe scénique. J’ai du mal à le comprendre… lorsqu’on pense au nombre de mises en scène médiocres qu’on présente par-ci, par-là, à grand renfort de « marketing ».
Du point de vue musical on a eu de grands moments de bonheur : Ivor Bolton signait magistralement sa dernière collaboration en tant que chef titulaire de la maison (Gustavo Gimeno en prendra le relais) face à un orchestre lumineux et transparent à souhait. On dirait qu’ils passent leur vie à jouer Mozart, tellement le style leur est familier, alors qu’ils doivent s’adapter en permanence à des univers radicalement différents. La manière dont ils traitent les récits « accompagnati » est remarquable. Ils ont l’habitude d’inviter un concertmeister spécialisé dans tel ou tel répertoire et cela semble payer. Les quatre cors de l’ensemble jouent sur des instruments « naturels » dont on sait à quel point le maniement est hasardeux. Jorge Monte de Fez signera chaleureusement sur scène la partie solo de l’air de Sifare « Lungi da te, mio bene ».
Sur le plateau, Juan Francisco Gatell campe un « Mitridade » de tout premier ordre : il réussit à mettre en second plan l’immense difficulté vocale du rôle, à la tessiture impossible et sans le moindre répit, tout en assumant à la perfection sa complexité scénique. « Se di lauri il crine adorno », son air d’entrée, mène la voix aux extrêmes, même si l’on peut supposer (mais rien n’est moins sûr, car nous manquons de beaucoup de recherches en ce sens) que Mozart ait eu à Milan un diapason un peu plus confortable que le « La » à 440 actuel. Comme « Farnace », Franco Fagioli a eu plus de fil à retordre : on l’a senti peu en forme, avec beaucoup de moments où la projection restait problématique et l’émission imprécise ou peu confortable. Sans doute, un mauvais jour. Il a fallu attendre son dernier air : « Già dagli occhi il velo tolto » pour qu’il nous livre toute la mesure de son incontestable talent. À ses côtés, Sifare était défendu par Elsa Dreisig, une artiste extrêmement attachante qui chante avec un naturel et une grâce ravissants. Je l’écoutais pour la première fois sur le vif et, paradoxalement, elle m’a paru un peu moins engagée et créative que dans ses performances pour les médias. C’est comme si elle voulait prendre une certaine distance avec ce rôle aux multiples ambiguïtés. Franco Klisović (« Arbate ») et Juan Sancho (« Marzio ») défendent plus qu’honorablement leurs parties. Mais c’est du côté des deux autres dames, Marina Monzó (« Ismene ») et Sara Blanch (« Aspasia ») que la barre, déjà très haut placée, monte en flèche : Monzó possède une voix lyrique, bien sonore et dense, avec une colorature d’un brillant et d’une élégance tellement déconcertants qu’on est immédiatement conquis par l’artiste. Et, par sa présence et un jeu de scène très crédible, elle défend un rôle relativement peu dessiné.
On peut affirmer sans ambages que Sara Blanch est l’un des sopranos le plus intéressants de nos jours. Le hasard a voulu que j’ai pu l’admirer récemment dans quatre rôles aussi différents que « Norina » (Donizetti) « Oscar » (Verdi) et puis « Köningin der Nacht » et maintenant « Aspasia » de Mozart. C’est intelligent, engagé, vocalement splendide et toujours authentique, tant dans son jeu de scène que dans son irréelle maîtrise technique. Elle dessine des « colorature » d’une précision absolue, mais en les intégrant toujours dans la phrase musicale, sans les en détacher pour l’exhibition. Cela aurait ravi le regretté Alberto Zedda, le grand prédicateur de la colorature rossinienne ou mozartienne. Mais je suis frappé aussi par l’extrême régularité de ses performances : elle est inlassablement au mieux de sa forme, c’est quasiment provocateur. Connaît-elle les mauvais jours ?
Le grand Eduardo Del Pueyo disait : « Les bons jours, ça existe… mais il faut les mériter !
Madrid, Teatro Real, le 23 mars 2025
Xavier Rivera
Crédits photographiques : © Monika Rittershaus


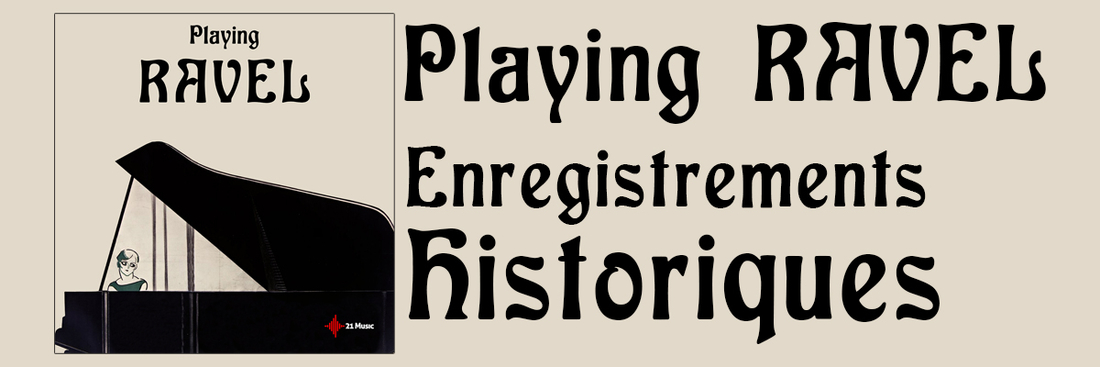


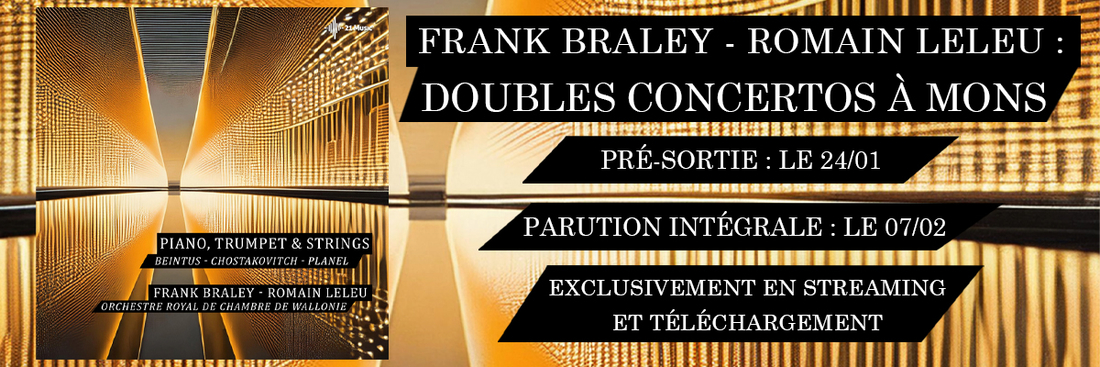




1 commentaires