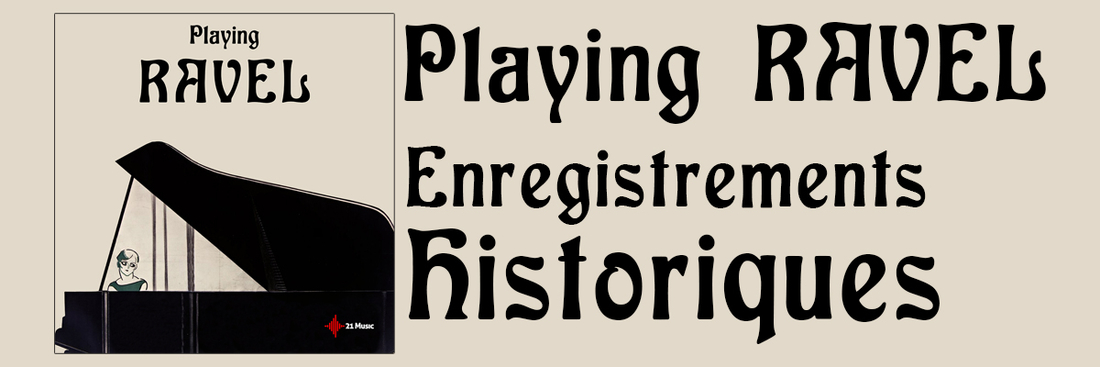Réédition audiophile du légendaire cycle beethovénien de Furtwängler

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Symphonies no 1 en ut majeur Op. 21, no 2 en ré majeur Op. 36, no 3 en mi bémol majeur Op. 55, no 4 en si bémol majeur Op. 60, no 5 en ut mineur Op. 67, no 6 en fa majeur Op. 68, no 7 en la majeur Op. 92, no 8 en fa majeur Op. 93, no 9 en ré mineur Op. 125. Wilhelm Furtwängler, Orchestre philharmonique de Vienne, Orchestre philharmonique royal de Stockholm, Chœurs et orchestre du Festival de Bayreuth. Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Elisabeth Höngen, contralto. Hans Kopf, ténor. Otto Edelmann, basse. 1948 1954. Livret en français, anglais, allemand. TT 78’05, 68’34, 74’48, 71’03, 77’21, 35’10. Warner Classics 5054197138881
Pour tout artiste d’hier qui, au gré d'une discographie fréquemment réalimentée, se voit aussi généreusement documenté que le légendaire Wilhelm Furtwängler (1886-1954), deux attraits peuvent justifier une énième parution : la révélation d'inédits, et la plus-value pour l’oreille. C'est sous ce deuxième appât que l'on pourra convoiter le présent coffret, qui semblerait à première vue un simple rhabillage de celui précédemment diffusé par Warner en 2010, aux bons soins des ingénieurs d'Abbey Road. Ce tout récent boîtier s'inscrit toutefois dans le sillage du pavé de 55 CDs publié l'an dernier, en collaboration avec Christophe Hénault pour la rénovation des bandes, et propose même trois frais remasterings non inclus dans ledit pavé ! De surcroît, l’expertise du Studio Art & Son d'Annecy se trouve ici parangonnée par le support SACD, qui mieux qu’aucun CD magnifie le grain charnel des cordes viennoises, nourrit la sensation d’espace et inscrit l’orchestre dans une perspective stable et réaliste. Cependant, les meilleurs remèdes ne pourraient transfigurer la compacte physionomie des symphonies 2 et 8 captées live en 1948 qui, quelle que soit la qualité technologique du transfert, disgracient l’homogénéité sonore de ce cycle, –patché depuis 1972 par cette ingrate mouture de l’opus 93 sauvegardé à Stockholm, aux fins que la Voix de son Maître puisse alors ficeler une intégrale. On peut se réjouir que la présente compilation conjoigne une prise alternative de la Cinquième, mais on peut regretter que la durée relativement courte de ce CD 6 n'ait par exemple été abondée par l’Inachevée de Schubert immortalisée à Copenhague lors des mêmes sessions du 1er octobre 1950. Autre relative déception : malgré l’intéressante notice signée de Rémy Louis, le livret aurait pu corroborer la dimension collector en étoffant l’iconographie et le matériel éditorial.
Concernant la biographie et le style général, l’on se réfèrera à l'érudite présentation de Stéphane Topakian voilà deux ans en nos colonnes. Rappelons-en quelques traits choisis. D'une vaste culture humaniste (les sources helléniques, la Renaissance italienne...), ce fils d'archéologue s’érigea comme un ambassadeur de l'art allemand, et se percevait comme un dépositaire de la tradition romantique, même s’il s’engagea aussi pour le répertoire contemporain (création à Francfort en 1927 du premier concerto pour piano de Bartók, à Berlin en 1928 des Variations op. 31 de Schoenberg…). Tandis qu’il proclama ne pas se mêler de politique, son sacerdoce devint lourd à assumer sous le régime national-socialiste, avec lequel il entretint des liens douteux, que la morale jugea et dans une large part disculpa. On imagine le tourment imposé à celui qui fut écartelé entre la fierté de servir la culture germanique et sa transmission vécue comme un apostolat, mais nonobstant accablé par les atrocités commises pendant le IIIe Reich. Sa carrière reste surtout associée à deux illustres formations européennes : les Wiener et Berliner Philharmoniker, qu’il dirigea depuis le début des années 1920 jusqu’à sa mort, même si un poste lui fut proposé en 1949 auprès de la prestigieuse phalange de Chicago. Car ses tournées le menèrent aussi loin qu'au Caire et outre-Atlantique, –au nord du continent et à Buenos Aires.
Furtwängler entretint des relations compliquées avec Arturo Toscanini, chacun trop conscients de leur valeur pour que l’admiration réciproque ne le dispute à la jalousie, voire à la rivalité notamment sur le sol américain où il ne revint jamais après 1927. À son retour, une diatribe égratigna le maestro moustachu qui, sans rancune, lui offrit sa succession à New York en 1936 pour tenter de le soustraire à l’emprise du nazisme. Esthétiquement, les deux chefs incarnaient des pôles qui ont souvent permis de diamétraliser le vecteur interprétatif. Aux antipodes de la précision et de l'objectivité extirpées par le sourcilleux Italien, le disciple du mythique Arthur Nikisch forgea une empathie où règne l’introspection sous une apparente improvisation, lui qui ne goûtait guère les répétitions, privilégiant l'inspiration du moment et la célébration avec le public –à l'instar d'un Sergiu Celibidache, mais sans virer au culte de la personnalité. Un adepte de la pulsation et du sentiment intériorisé plutôt que de la stérile carrure métrique. Une démarche vivante et spontanée visant à recréer par des moyens quasi-démiurgiques, celle d’un « subjectiviste qui philosophait » selon la formule de Daniel Barenboim qu’on peut lire sur son site. Plutôt un exégète qu’un rigoureux architecte, avide du contenu, du message, qui savait décrypter la structure névralgique des œuvres et en redéployer les arcs de tension. Ainsi cette Pastorale qui culmine non lors de la Tempête mais dans les Sentiments joyeux et reconnaissants après l'orage, où l’on pourra s’enivrer de la pression progressivement et imparablement instillée. La première symphonie rencontre l'élégance raffinée et incisive d'un Felix Weingartner avec le même orchestre quinze ans auparavant, mais l'influx de son successeur paraîtra moins superficiel et plus habité.
Jouer l’œuvre non telle qu’elle est transcrite, mais comme l’auditeur devrait l’entendre, grâce à une direction jamais littérale mais orientée par une phénoménologie de la perception, que ce soit pour le dosage dynamique (sa science du crescendo) ou la résonance harmonique. On mentionnera ainsi le fameux décalage d’impulsion des levées, arrimant des basses qui soulevaient le reste des pupitres en exsudant la richesse des accords : entendre les deux semonces qui lancent l’Eroica non comme une détonation mais comme un coup de bélier qui a réfléchi son élan. Ou encore dans la Marcia funebre comment s’échafaude à 10’25 la codetta de la mesure 158 après le fugato : la puissance rituelle s’y allie à l’intensité quasi sacramentelle. En revanche, l’accent liminaire de la Septième semble partir des violons, engendrant une irisation qui n’a plus rien d’une chape, et infléchit une exécution aussi délestée que lumineuse du Vivace -comme aspirée vers les hauteurs, à l’instar de la scansion ascensionnelle d’un Günter Wand au Gürzenich de Cologne. Les intuitions de Furtwängler pouvaient encore conduire à reconsidérer la ponctuation, ainsi l’ostinato de timbales dans l’Andante cantabile con moto de la no 1.
Dans le livret, la citation de Fred Goldbeck relativiserait l’indéchiffrabilité de sa battue. Une imprévisibilité qui suscita nombre d’anecdotes émanées de ses pupitres, certaines aussi fétichistes qu’attaquer une phrase lorsque la baguette atteignait le troisième bouton de la veste, si l’on en croit Norman Lebrecht (The Maestro Myth, éd. trad. JC Lattès, 1996, p. 107) -un attribut dont il semblait, sur certaines vidéos, la proie malencontreuse plus que l’ordonnateur. Furtwängler entretenait cependant une relation symbiotique avec ses musiciens, encourageant l’écoute mutuelle plutôt que la stricte observance, garantissant des fluctuations agogiques au sein de la respiration sous-jacente. Au prix d’une communication ésotérique qui devait se contenter d'explications succinctes pendant les répétitions. Son habitude de diriger par cœur les yeux fermés semblerait traduire une divination chamanique, et pourtant il révisait intensément les partitions avant les concerts.
Furtwängler essuya une réputation de lenteur même s’il n'hésitait pas à accélérer certains passages jugés moins cruciaux, et malgré ses tempos incomparablement actifs dans un opéra aussi propice à la contemplation que Parsifal. Cette modération n’est pas une allégation usurpée dans une Quatrième qui ausculte et redistribue les énergies intrinsèques. Certes, face à des agitateurs comme Hermann Scherchen en son intégrale gravée peu après avec mutatis mutandis les mêmes instrumentistes, la confrontation s’avère aussi aisée qu’édifiante dans la Pastorale, -un portrait de l’unité et de l’harmonie de l’âme humaine avec la nature, ainsi que la considérait Furtwängler, dans une veine rousseauiste, quasi piétiste. Allure près d’un quart plus lente que son confrère pour l’Éveil d'impressions agréables en arrivant à la campagne, plus que jamais épiphanique, à raison de la souplesse et de la continuité du flux qui abolit la découpe métrique. On succombera à l’édénique sérénité qui s’empare de la Scène au ruisseau, quoiqu’il existe des parcours bien plus quiets sous les charmes d’un Carlo Maria Giulini (à Londres ou Los Angeles) ou du dernier Bernstein, dans ce Musikverein d’ailleurs (DG). La délicatesse de l’Allegretto de l’opus 92 avance à pas feutrés et récuse tout engourdissement morbide, à la faveur d’un lyrisme sublimé. A contrario, on jaugera l’éventail de tempi dans le consécutif Scherzo, qui ne met pas deux pieds dans le même sabot et impressionne par sa motricité ; puis on acquiescera à la santé rythmique du Finale, où Furtwängler réussit une parfaite dialectique entre des instincts aussi contrariés que l’apollinien et le dionysiaque : « c'est le skieur, fou de vitesse, qui cultive sur la pente le sens infaillible de l'équilibre », résumait par métaphore André Tubeuf (1930-2021).
On prêtera bien sûr attention à deux symphonies particulièrement prisées et emblématiques, notamment la Cinquième, d'autant qu'elle est celle qui revint le plus souvent dans les concerts de Furtwängler, tous compositeurs confondus. Au travers de ses multiples témoignages audibles, on sait comment il singularisait les cinq mesures initiales du motif du destin, qu’il articulait méthodiquement et amplement autour des points d'orgue. Les différents enregistrements manifestent néanmoins des univers expressifs qui ne se dupliquent guère, si l'on oppose aux foudroyantes et sombres gravures de guerre (juin 1943) la vision extatique et émancipatrice que nous entendons dans le CD 3.
Cet avatar de la Neuvième qu'il n'aborda jamais en studio recèle une portée symbolique, investie comme une consécration quand Furtwängler fut invité à la diriger en juillet 1951 pour la réouverture du Festival de Bayreuth après la Seconde Guerre mondiale, dans un pays qu'il ne s'était pas résolu à quitter malgré les troubles années qui le perclurent sous les fourches caudines et le contraignirent à l’ambiguïté. Analysant comment Toscanini peaufinait inlassablement la nébuleuse introduction de l'Allegro ma non troppo, il déclara que « l'on entend ce passage exactement comme il est écrit, avec une clarté impitoyable, mais l'idéal de Beethoven s'évanouit » (Lebrecht, op. cit., p. 105). Dans ce brouillard d’une aube primordiale, on peut déceler comment Furtwängler façonne un développement organique, sertit l'interdépendance des cellules thématiques, et prouve son génie dans les processus transitionnels prodigieusement intégrés. Dans son magnifique enregistrement de 1977 (Deutsche Grammophon), d'une éloquence certes plus mobile et flamboyante, Karajan (que Furtwängler dédaignait comme « Monsieur K ») ne procédera pas différemment en ajustant le moindre détail subsumé à l’insécable et centripète cohérence du discours. En dépit de quelques scories (cornistes) et flottements, on pourra admirer comment l'Adagio se décante ensuite avec une absolue simplicité de ton et d’intention, en totale sympathie avec ce qui semble un rituel collectif humblement partagé, préparant à une Ode à la joie portée à bouts de bras, dont le cérémonial est à la hauteur de l’événement, quoique sans l’outrance que légitimerait le contexte. La postérité admettra la pureté et la grandeur du geste pacificateur, s’évertuant, non sans détachement ni une certaine désillusion, à renouer avec un idéalisme ébranlé par la fureur d’un nationalisme qui fractura sa patrie spirituelle. Un héritage qu’il savait devoir refonder (« il faut sauver la musique allemande ! », lui avait déjà enjoint Arnold Schönberg), et bientôt sans lui qui s’éteignit dans l’amertume, emporté par une bronchite qu’il refusa de traiter.
Inutile de préciser la valeur patrimoniale de cet incalculable legs, qui fut commenté et loué sous toutes les coutures et latitudes par désormais plusieurs générations de critiques et mélomanes, et où peuvent s’identifier diverses facettes du romantisme austro-allemand : échos tardifs des contrastes Sturm und Drang, tendre poésie schubertienne, organicisme wagnérien. Un héritage prôné par de nombreuses baguettes qui s'en influencèrent, comme Zubin Mehta ou Claudio Abbado. Quiconque possédant déjà de nombreuses versions des symphonies de Beethoven gagnera à se (re)pencher sur ces témoignages mieux qu'aucun autre susceptibles de nous en révéler le zèle créateur au travers d’angles incessamment renouvelés, venant d'un maestro qui n'hésitait pas à réétudier des textes qu'il avait dirigés des centaines de fois.
Degré zéro de l’opportunisme ? On connaît des chefs qui inféodèrent le Maître de Bonn pour se mirer dans son génie, valoriser leur charisme (ne penserait-on à l’orgueilleux Willem Mengelberg que nous adorons ?) ou défendre un dogme accessoire (les futurs HIP et la pharmacopée senza vibrato). À l’époque du naissant 33 tours, les vétérans Carl Schuricht (HMV), bientôt Pierre Monteux (Decca) qui au demeurant disposa avec le LSO d’un outil plus tranchant que le WP, et dans sa foulée le moderniste René Leibowitz : eux trois confièrent aux micros leur regard décapant sur le corpus. L’intemporel Furtwängler obéissait à sa liberté d'artiste, sans souci de révolution, ni même peut-être de permanence. Celle d'un alchimiste un peu mystique et pas peu nietzschéen, dévoué à débusquer ce qui pour lui constituait la substance des œuvres, leur surgissement. À peine ancillaire : les servir, sans servilité, mais avant tout les comprendre. Si ce n’est dans ces décennies la profondeur d’un autre métaphysicien en la personne d’Hermann Abendroth, des lectures aussi intelligentes encourent peu de concurrence. L’éthique d’un anachronique passeur, qui fut toujours « un étranger dans ce monde » selon Barenboim. On profitera de cet avantageux coffret, nanti de conditions sonores optimisées, pour revisiter ce nourricier monument de l’histoire phonographique, par un de ses médiateurs les plus émouvants… quoiqu’il se méfia longtemps de l’inauthenticité du disque.
Son : 3 à 8,5 – Livret : 8,5 – Répertoire : 10 – Interprétation : 10
Christophe Steyne